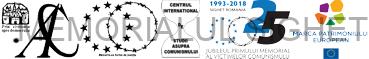À Sighet, aux confins de la Roumanie et de l’Ukraine, quelques anciens dissidents ont entrepris de transformer un centre de détention de prisonniers politiques en un Mémorial aux victimes du communisme.
Le 8 décembre 2004, eut lieu en direct l’un de ces petits miracles que la télévision nous réserve parfois. Lors du débat entre les candidats au second tour de l’élection présidentielle roumaine, Traïan Basescu, maire de Bucarest, fit sensation en déclarant, face au Premier ministre sortant, Adrian Nastase, et devant les Roumains stupéfaits : « Je me demande si notre pays n’est pas maudit, lui qui se voit contraint de choisir entre deux anciens communistes ? […] En quinze ans, il n’y a pas eu un seul homme politique qui n’ait été souillé par les mauvaises habitudes du communisme, qui n’en ait été affecté d’une façon ou d’une autre. […] Peut-être le moment est-il venu pour qu’un autre genre de candidat se présente devant les Roumains, plutôt que nous deux. Le gros problème que nous partageons n’est pas seulement lié au fait que nous étions tous deux membres du Parti communiste. […] Le drame, c’est que nous n’avons plus le droit de conserver la même mentalité quinze ans après la disparition du communisme en Roumanie. » Constat terrible, constat exact. Déjà, lors de l’élection présidentielle de 2000, les candidats du second tour étaient Vadim Tudor – un poète, exfavori de Nicolas Ceausescu, reconverti dans l’ultranationalisme antisémite – et Ion Iliescu, vieil apparatchik communiste, ancien ministre du « Conducător » et principal metteur en scène de la « vraie-fausse » révolution qui se déroula en Roumanie en décembre 1989.
AMNÉSIE ET AMNISTIE DES CRIMES COMMUNISTES
Après la chute du mur de Berlin, la tristement célèbre Securitate – la police politique – et les dirigeants communistes roumains craignaient fort de perdre un pouvoir qu’ils contrôlaient depuis quarantecinq ans. Ils ont donc fait distribuer des armes dans la rue, histoire de faire croire à une révolution démocratique, provoquant ainsi le chaos avec à la clé plus de mille cinq cents victimes. Simultanément, ils ont organisé l’abominable mise en scène de Timisoara, dévoilant devant les caméras du monde entier un prétendu charnier annoncé comme la face visible d’un massacre de plusieurs milliers de personnes, ordonné par Ceausescu. Beau prétexte pour assassiner le dictateur et sa femme et les désigner comme seuls responsables de toutes les horreurs de l’un des pires régimes totalitaires en Europe.
Au moment voulu, les manipulateurs sont sortis de l’ombre et, sous le nom de Front du salut national, ont ramassé le pouvoir sans coup férir, poussant sur le devant un jeune et fringant Premier ministre, Petre Roman, fils d’un haut nomenklaturiste étroitement lié aux services soviétiques depuis l’avant-guerre. Inutile de préciser que, dans ces circonstances, les victimes du régime communiste et les démocrates qui espéraient sortir du cauchemar n’eurent pas droit à la parole. Et quand ils tentèrent d’élever la voix, Ion Iliescu les fit tabasser et bastonner par des bandes de mineurs – ou de membres de l’ex-Securitate déguisés en mineurs – qui avaient ordre de « casser de l’intello ». C’est les 14 et 15 juin 1990 que se déroulèrent à Bucarest ces scènes de lynchage officiel que les Roumains nommèrent « minériades ». De son côté, Petre Roman affirmait que les victimes du communisme – mortes ou emprisonnées – n’avaient pas dépassé les dix mille, alors que le chiffre réel est plus proche de cinquante mille. Enfin, la plainte déposée par le sénateur Constantin Dumitrescu, président de l’Association des anciens détenus politiques, contre deux cents tortionnaires connus de la Securitate fut classée sans suite et, peu après, le sénateur fut victime d’un grave accident de la route opportunément provoqué, opération caractéristique des méthodes de la Securitate. Dans un tel climat, impossible de mener le moindre procès du régime communiste et de ses tortionnaires : les uns s’enfuirent à l’étranger pour échapper à toute condamnation éventuelle, d’autres moururent tranquillement dans leur lit, alors que certains… se propulsaient au sommet du pouvoir.
Et pourtant ! La « minériade » poussa quelques intellectuels à réagir. Menés par la poétesse Ana Blandiana, ils créèrent une association, l’Académie civique, qui décida de se battre pour apprendre aux citoyens roumains la vérité sur leur propre histoire, après un demi-siècle de dictature, d’enfermement et de censure. L’Académie civique se lança dans la création d’un Mémorial à la mémoire des victimes du communisme et de la Résistance, installé dans la petite ville de Sighet. Elle publia, en 1998, l’édition roumaine du Livre noir du communisme dont le tirage fut épuisé en quelques semaines, et, dans la foulée, m’invita en Roumanie.
SIGHET
C’est en 1999 que, pour la première fois, je me rends à Sighet. En raison d’une malchance insigne, je rate mon avion – le seul que j’ai jamais raté ; puis j’attrape à Bucarest l’un des rares trains pour Sighet, un train de nuit. Même en plein après-midi et par un chaud soleil, la gare est franchement glauque, fréquentée par une faune indéfinissable de filles très jeunes, outrageusement maquillées et déshabillées, et de petites bandes de garçons dont j’expérimente très vite la méthode qui consiste à grimper dans les wagons quelques minutes avant le départ, à dévaliser les voyageurs et à s’enfuir à toutes jambes. Un trajet de 450 kilomètres, quatorze heures d’un wagon-lit d’époque qui vous font arriver au petit matin dans les brumes du Maramures, province du nord-ouest de la Roumanie, coincée entre la Hongrie à l’ouest, la Ruthénie subcarpatique – l’extrémité orientale de la Tchécoslovaquie, occupée et annexée par Staline en 1945 – au nord, et à l’est la Bucovine, terre des monastères, souvent fortifiés en raison des incessantes invasions ottomanes, et dont les murs extérieurs des églises sont couverts de magnifiques fresques de style byzantin. Du train qui roule à toute petite vitesse sur une voie unique, je découvre une région de collines très semblable au piémont des Pyrénées. La nature y est encore sauvage : c’est ici que Ceausescu et ses hôtes de marque venaient chasser l’ours. Le mode de vie rural y reste très traditionnel – ce fin fond de l’Europe a bien résisté à la pénétration communiste : pas de tracteurs mais des chevaux omniprésents dans les champs, sur les routes, dans les rues des villages ; des greniers à foin originaux et superbes, et de belles fermes individuelles. Les gens y ont conservé des moeurs rustiques : les mariages s’y déroulent encore au son des musiques traditionnelles – violon, flûte, tambour. Le mets de choix y est toujours un large morceau de couenne de cochon, légèrement grillé, roulé comme un cigare et plongé dans un pot de gros sel, le tout arrosé de quelques bonnes lampées de palinka, l’alcool de prune local. Le train ne va pas plus loin. Terminus Sighet, la « capitale » du Maramures, située sur la Tisza, une rivière qui prend sa source en Ukraine et se jette dans le Danube en amont de Belgrade, après avoir traversé la Roumanie et la Hongrie. Impression de bout du monde, mais je suis accueilli avec des fleurs par Ana Blandiana, son mari Romulus Rusan et une joyeuse équipe. Sighet est à cette époque une triste petite ville tout en longueur, sale, aux rues parsemées de nids-de-poule et où les seuls bâtiments à peu près en état sont les églises – catholique, orthodoxe et temple luthérien – qui datent de l’époque où le Maramures appartenait à l’Empire austro-hongrois.
Nous sommes dans la ville natale d’Elie Wiesel, mais ici, les nazis ont exterminé la communauté juive dont la seule trace est un vieux cimetière laissé à l’abandon. L’hôtel où je loge, sur la place principale, ressemble à un vaste caravansérail assez délabré. Le robinet du lavabo ne délivre un filet d’eau qu’unquart d’heure le matin et le soir. Des passants pauvrement vêtus, des enfants gitans qui vont pieds nus et mendient, peu de voitures dans les rues, mais des carrioles dont les chevaux sont joliment harnachés – le seul « progrès » sous le communisme a été le remplacement des roues en fer par de vieux pneus récupérés. Seul signe de vie encourageant : ces nombreux paysans en chapeau et ces robustes paysannes en fichu multicolore et jupe courte mais bouffante, qui tiennent marché tous les jours. Derrière ce décor quelque peu désespérant, je découvre soudain une entreprise extraordinaire, inimaginable dans ce coin perdu au fin fond de l’Europe. À 200 mètres de l’hôtel, à deux rues à droite, se dresse un imposant bâtiment en parfait état : la prison. Car tout a fini et tout recommence dans cette prison. C’est là que les communistes ont détruit la Roumanie d’avant 1940, c’est là que la Roumanie d’après 1989 reprend le cours de son histoire.
LE MÉMORIAL
Après 1945, Sighet, situé sur la frontière soviétique, était aussi l’un des points les plus éloignés de Bucarest. Pour cette double raison, le régime communiste, à partir de 1948, y emprisonna et y fit disparaître les principales personnalités roumaines de l’opposition. C’est ici que Iuliu Maniu, le grand leader du Parti national-paysan et ex-Premier ministre, mourut de manque de soins en 1951, tout comme cet autre ex-Premier ministre, Constantin Bratianu, le chef du Parti nationallibéral. L’un des principaux historiens roumains, Gheorge Bratianu, qui avait soutenu sa thèse à la Sorbonne et était le collègue et l’ami de Marc Bloch, y subit le même sort en 1953, à peine âgé de cinquante-quatre ans. Tout comme deux autres anciens Premiers ministres et neuf évêques de rite catholique et gréco-catholique. Au total, cent quarante personnalités assassinées à petit feu et jetées dans les fosses communes d’un terrain vague, dont, aujourd’hui encore, les dépouilles n’ont pu être identifiées. Or, cette prison, désaffectée depuis longtemps – la plupart de ses « clients » ayant trépassé – était presque en ruine quand, en 1993, Ana Blandiana et ses amis de l’Académie civique décidèrent d’y créer le Mémorial. Il serait trop long de décrire leur invraisemblable parcours du combattant pour obtenir que la municipalité et l’État leur cèdent le bâtiment, puis pour faire reconnaître ce projet par le Conseil de l’Europe, et enfin pour récolter les fonds nécessaires à la réhabilitation du bâtiment, tant auprès d’institutions internationales – en particulier la fondation Konrad-Adenauer – que de nombreux Roumains exilés à l’étranger sous le régime communiste.
Une fois réhabilitée, la prison a été transformée en musée. Curieusement, ce bâtiment de deux étages, prison modèle de la fin de l’Empire austrohongrois, organisé autour d’un long couloir aux murs percés de dizaines de lourdes portes, et aux deux extrémités éclairées d’une haute verrière, ressemble à la nef d’une cathédrale et appelle à la méditation. Plus de soixante cellules y sont aménagées enautant de lieux d’exposition. Ici, une cellule est consacrée aux prisons, là au goulag du canal du Danube où périrent des milliers de forçats dans un chantier sans objet, plus loin aux asiles psychiatriques à caractère politique, puis aux lieux d’exécution et aux fosses communes. Une place de choix est réservée aux victimes. Une salle est consacrée à Maniu. Une autre à la famille Bratianu. Une autre encore aux populations d’origine allemande ou serbe, installées en Roumanie depuis des siècles et déportées en bloc dans la nuit de la Pentecôte 1951 – quarantetrois mille huit cent quatre-vingt-dixneuf hommes, femmes et enfants abandonnés au beau milieu de la steppe insalubre du Baragan. Les bourreaux ne sont pas oubliés : ceux du Parti communiste – qui ne comptait que quelques centaines de membres lors de sa prise de pouvoir sous occupation soviétique –, ceux de la Securitate – il y a même la reproduction d’une salle d’interrogatoire –, ceux qui mirent en oeuvre la terrible expérience de la prison de Pitesti où, sous peine de mort, des dizaines d’étudiants anticommunistes – ou tout simplement catholiques ou orthodoxes – furent contraints de se torturer les uns les autres, tant physiquement que psychologiquement, jusqu’à ce que leur personnalité soit détruite ou… que mort s’ensuive. Plus surprenantes, les cellules qui évoquent la résistance de la population à l’oppression communiste. La résistance armée dans les montagnes, dont les derniers combattants furent assassinés en 1962. La résistance passive des paysans à la collectivisation. La résistance massive des ouvriers en grève à Brasov le 15 novembre 1987. La résistance isolée des intellectuels et dissidents. Le tout dans une mise en forme muséographique très professionnelle, élaborée par une conservatrice du musée de Bucarest – fille d’un prisonnier politique – qui, presque seule, protégea ses collections du désastre lors de la « vraie-fausse » révolution de 1989. Dans la cour de la prison, un groupe de statues symbolise les martyrs. Par une rampe dont les murs portent les noms des victimes jusqu’ici recensées, on accède à un lieu de recueillement. Inauguré officiellement en 1997, le Mémorial a été déclaré d’intérêt national par le Parlement. Aujourd’hui, de toute la Roumanie affluent des visiteurs – des touristes, des groupes scolaires – qui découvrent la véritable histoire de leur pays au cours du dernier demi-siècle, une histoire tragique largement occultée par le pouvoir néocommuniste depuis 1989.
HISTOIRE ET MÉMOIRE
L’Académie civique a accompagné la création du Mémorial d’un très important travail d’histoire et de mémoire. Face au pouvoir qui bloquait l’accès aux archives et à l’Académie roumaine qui, en dépit de la disparition de son « président d’honneur » (Ceausescu), manifestait toujours sa soumission au gouvernement, elle a engagé dès 1992 une énorme entreprise d’histoire orale, enregistrant des milliers d’heures de témoignages des victimes. Depuis 1995, elle a organisé plusieurs colloques internationaux sur l’histoire du communisme en Roumanie, et elle publie cinq collections – Actes des colloques, Documents, Histoire orale, etc. – qui totalisent déjà plus de vingt mille pages. Et, bien entendu, elle constitue pas à pas une importante bibliothèque mise à disposition des chercheurs. Cependant, cette activité ne secouant que faiblement l’inertie générale, Ana Blandiana et Romulus Rusan ont décidé de reprendre le problème à ses fondements, avec la jeune génération. En 1999, ils ont créé une école qui regroupe au Mémorial, chaque été pendant huit jours, une centaine de jeunes de quinze à dix-huit ans, venus de toute la Roumanie – et aussi de la république de Moldavie, province roumaine occupée et annexée par Staline en 1940 –, sélectionnés par un concours du même type que notre concours de la Résistance. Depuis plusieurs années, Ana Blandiana m’a demandé d’être le « recteur » de cette école, titre bien pompeux pour une tâche qui consiste avant tout à veiller à ce que les cours commencent à l’heure, que les conférenciers n’endorment pas leur jeune auditoire à coups d’exposés trop long ou trop académiques, que chacun puisse poser les questions qui lui tiennent à coeur et que soient tirées, de temps en temps, quelques conclusions synthétiques. Interviennent alternativement des témoins, des acteurs historiques et des universitaires roumains et étrangers. On y vit des moments uniques. Ainsi, quand, en 2002, l’invité d’honneur, Vladimir Boukovski, raconta pendant plusieurs heures son expérience de dissident, martyrisé dans les « hôpitaux » psychiatriques soviétiques, devant un auditoire bouleversé. Plus tard, « Vlad » était ravi de converser en russe la moitié de la nuit – vodka à l’appui – avec les jeunes Moldaves, alors en pleine révolte contre leur gouvernement toujours communiste qui tentait de réimposer le russe obligatoire dans les écoles et les lycées. Grandes leçons de dignité et de résistance à l’oppression. Autre moment magique, en juillet 2005, quand dans la « nef » de la prison-Mémorial, devant les élèves réunis, une violoniste joua la Chaconne de Bach. Cette jeune femme, petite-fille d’un prisonnier politique, dont la mère s’était exilée en France, et qui venait pour la première fois à Sighet avec sa propre fille adolescente, sut faire passer une formidable émotion et faire ressentir le caractère tragique du lieu. Moment terrible, aussi, avec le témoignage de Ioanna-Raluca : son père, militaire de carrière, était le chef d’un maquis anticommuniste ; traqué depuis 1949, il fut arrêté en 1958 à la suite d’une trahison, jugé et exécuté. Arrêtée, sa femme fut condamnée à perpétuité et mourut en prison. Leur fille – Ioanna –, alors très jeune, fut confiée à un orphelinat et ce n’est qu’après 1989 qu’elle découvrit la vérité, et seulement en 1997 qu’elle fut autorisée par la justice à porter le nom de son père, Toma Arnautoiu. Moment inattendu quand, le 14 juillet, la centaine d’élèves s’est levée pour chanter une joyeuse Marseillaise – apprise où ? quand ? comment ? À ce moment précis, j’ai regretté que ’ambassadeur de France ne soit jamais allé jusqu’à Sighet et que la France demeure largement indifférente à la tragédie vécue par tous ces pays d’Europe centrale et orientale communisés par la terreur.
Depuis un an ou deux, la situation de Sighet s’améliore, une certaine prospérité s’y manifeste. Quant aux jeunes de l’école d’été, ce ne sont plus les adolescents un peu tristes et très pauvres de la fin des années 90. Ils sont tous armés de portables, de baladeurs, d’appareils photo numériques, parlent plusieurs langues, sont allés à l’étranger. La nouvelle Roumanie entre en scène, bien décidée à s’en sortir, mais aussi à regarder en face la tragédie vécue par ses parents et grands-parents. Encore faudrait-il, pour que la réunification européenne ait un sens, que les Européens de l’Ouest prennent conscience de cette tragédie et contribuent au pénible travail d’histoire et de mémoire, seul moyen, à terme, de reconstruire l’identité de sociétés dévastées par l’oppression communiste.
Le Meilleur des Mondes n°1 * printemps 2006