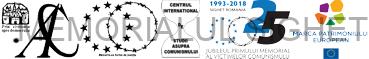Addenda la Cartea Neagră a Comunismului, Bucureşti 1998, Paris 2002, Munchen 2003
Réalisé sous l’égide de la Fondation de l’Académie civique
Avant-propos
Dès sa parution, Le Livre noir du communisme s’est vu imposer une traversée du purgatoire. Attaqué avec acharnement par la gauche communiste, il a suscité en France une polémique de dimensions nationales. On lui a reproché de faire œuvre de propagande plutôt que d’histoire, d’être passionnel, dépourvu de sérénité, d’objectivité, et, surtout, de proposer une analogie entre le communisme et le nazisme, décrivant comme congénitalement proches les deux dogmes qui ensanglantèrent notre siècle. Les contestataires ont également placé sous le signe du doute l’estimation du nombre de victimes du communisme. Des centaines d’articles pour et contre s’affrontèrent dans ce tournoi, et le livre atteignit, en dépit de ces diatribes, ou peut-être justement à cause de leur style agressif, un tirage record.
Surgirent ensuite les critiques venues de l’Est, formulées par les survivants de la répression communiste, qui découvraient de nombreuses lacunes dans les pages qui leur étaient consacrées. Le chapitre « L’autre Europe victime du communisme » – conçu comme une trame de données comparatives provenant des différents pays du Centre et de l’Est de l’Europe – comporte, inévitablement, des glissements d’accent et d’interprétation, dûs à la documentation inégale que l’auteur eut à sa disposition. Dans le flux de la synthèse, certains thèmes spécifiques pour tel ou tel pays étaient approfondis de manière différente, souvent réduits à des allusions et à des nuances. C’est là le risque de toute œuvre pionnière, mais aussi le résultat des inégalités enregistrées d’un pays à l’autre en matière de recherches d’histoire contemporaine. Alors qu’en Pologne et en République tchèque les archives sont désormais accessibles, permettant aux historiens d’analyser en profondeur la période communiste, dans les autres pays, dont la Roumanie, la recherche stagne. Les sources primaires n’y sont que partielles et disparates, et les études dues à l’exceptionnel effort de certains jeunes historiens demeurent des îlots solitaires au milieu d’un océan de confusion. En l’absence d’un programme de recherche systématique et global, les synthèses nationales se laisseront attendre encore longtemps. En Roumanie, par exemple, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’enquêtes, condamnées ou mortes pendant le régime communiste semble impossible à établir car les archives, éparses, sont plus ou moins difficiles d’accès et n’offrent pas une absolue garantie de fiabilité : on soupçonne certaines sources documentaires d’avoir été falsifiées dès leur rédaction ou d’avoir été détruites en cours de route. Des écarts considérables sont, par ailleurs, enregistrés entre la disponibilité des archives et les témoignages d’histoire orale ou ceux contenus dans les très nombreux livres de mémoires. Ainsi, les seules estimations existantes ont été obtenues par des méthodes mathématiques, en extrapolant certaines données partielles.
L’Addendum que nous publions dans l’édition roumaine du Livre noir du communisme ne saurait dépasser ces limites inhérentes et se résume à présenter le phénomène répressif sous différents angles. Quelques particularités du système concentrationnaire roumain ou du mouvement de résistance sont traitées comme des études de cas spécifiques, qui ajoutent de la matière aux chapitres pour la rédaction desquels les auteurs du Livre noir du communisme se sont heurtés à des difficultés de documentation. Nous espérons que cet Addenda pourra être intégré dans une future édition française du livre. Nous espérons également que, dans un avenir plus ou moins prévisible, il pourra constituer le noyau d’un Livre noir du communisme en Roumanie, dont l’élaboration dépend cependant de la multitude de facteurs énumérés plus haut.
Le long calvaire de la démocratie agressée par les totalitarismes de toutes sortes est difficile à reconstituer aussi longtemps que l’accès aux archives n’est pas libéralisé. Les souffrances subies et les sacrifices consentis au cours de ce douloureux cheminement ne pourront être analysés dans leur essence et mesurés à leurs dimensions réelles que lorsque la jeune génération d’historiens aura la possibilité d’accéder aux documents indispensables à l’élaboration de la synthèse tant attendue, et sera stimulée à s’en servir.
Romulus RUSAN
Introduction
À l’issue de la Première Guerre mondiale, la Roumanie voyait se réaliser son rêve de toujours : la réunification de toutes ses provinces historiques en un seul État. Le 9 avril 1918, la Bessarabie – région située à l’Est du pays que la Russie occupait depuis 1812 et qui avait proclamé son indépendance à la faveur du coup d’État bolchevique de 1917 – vota son rattachement à la Roumanie. La Bukovine, au Nord de la Bessarabie, faisait de même le 27 novembre. Le 1er décembre, la Grande Assemblée des Roumains de Transylvanie, Banat et Crisana plébiscita la réunification avec la Roumanie de ces provinces longtemps dominées par l’Empire austro-hongrois, puis par la Hongrie. Le Traité de Trianon entérinait cette décision, le 4 juin 1920. Le territoire national passait de 137 000 km2 à 295 000 km2 et la population de 8 millions à 18 millions d’habitants. En quelques mois seulement, le pays avait acquis une unité qu’il attendait depuis longtemps, mais qui sera de courte durée et lui coûtera très cher.
Ainsi épanouie, la Roumanie irritait inévitablement ses voisins. La première réaction vint de l’Ouest où, en juillet 1919, le gouvernement communiste hongrois de Béla Kun décida de lancer ses troupes à la reconquête de la Transylvanie. La riposte de l’armée roumaine, avec l’occupation de Budapest pendant trois mois, mit fin non seulement à cette tentative, mais aussi à l’expérience communiste de Kun. Cependant, à l’Est, la Russie bolchevique, ulcérée par la perte de la Bessarabie et de la Bukovine, commença un travail de sape qui, à long terme, allait produire les résultats escomptés.
C’est dans ce contexte – et c’en était peut-être même une résultante – qu’intervint, le 9 mai 1921, la naissance du Parti communiste roumain, affilié à la Troisième Internationale communiste (Komintern).Numériquement insignifiant– de 2 000 membres en 1923, il allait chuter à 1 000 durant la Deuxième Guerre mondiale –, le Parti communiste s’identifia vite aux intérêts soviétiques, menant constamment « une bruyante politique anti-roumaine » . D’ailleurs, à partir de 1924, tous les premiers secrétaires furent soit ukrainiens, soit bulgares, soit hongrois, élus lors de congrès qui se déroulaient à l’étranger et, en général, désignés directement par Moscou.
La première action retentissante des communistes, avant même la création officielle du parti, fut l’attentat perpétré par le militant Max Goldstein dans l’hémicycle du Sénat de Bucarest, le 8 décembre 1920, et qui fit plusieurs victimes. Mais cet « exploit » n’allait jamais être mentionné par la propagande du parti, qui préférait se vanter d’avoir organisé les grandes grèves des mineurs de la Vallée du Jiu, en 1929, et des cheminots de Bucarest, en 1933. Revendication abusive, car les deux mouvements ont été déclenchés à la suite de manipulations du Komintern, le Parti communiste roumain ayant servi simplement d’intermédiaire.
Leur attitude ouvertement anti-roumaine et leur militantisme en faveur du démembrement du pays, valurent aux communistes, dès 1924, d’être mis hors la loi. Ils n’allaient retrouver une existence légale que le 23 août 1944. Ajoutées à cela, les incessantes luttes intestines, l’absence d’influence syndicale, et les purges imposées par Staline dans les années 1930, contribuèrent à garder ce parti dans une position de marginalité permanente.
La Roumanie, en revanche, était entrée dans une période faste. Le suffrage universel fut introduit en 1918. Une grande réforme agraire, en juillet 1921, décida la redistribution de plus de six millions d’hectares de terres arables. En 1923, une nouvelle Constitution, s’inspirant largement de celle de la Belgique, consolidait la monarchie constitutionnelle et les institutions démocratiques. L’économie et la culture connaissaient un grand essor.
Cependant, la vie politique n’arrivait pas à se stabiliser. Les deux principales formations, le Parti national libéral et le Parti national paysan, se succédaient au pouvoir sans jamais achever leurs mandats. En 1926, le prince héritier Carol renonçait à ses droits en faveur de son fils, Michel, qui fut couronné, à l’âge de six ans, en 1927. Trois ans plus tard, le prince Carol rentrait d’exil et reprenait son trône sous le nom de Carol II. Mais un autre événement s’était produit en 1927, qui allait marquer en grande partie et pour de nombreuses années la politique roumaine : la création de la Légion de l’Archange Michel – plus connue sous le nom de Garde de Fer – organisation nationaliste qui se reconnaissait une certaine parenté avec le fascisme italien.
Face à l’instabilité politique interne et à la situation internationale de plus en plus trouble, le roi Carol II instaura, le 10 février 1938, une « dictature royale » se traduisant par la promulgation d’une nouvelle Constitution qui abolissait une bonne partie des institutions démocratiques existantes, et par la suppression des partis politiques. Quelques mois plus tard, le roi chercha à se débarrasser du problème de la Garde de Fer en ordonnant l’assassinat de son chef, Corneliu Zelea-Codreanu, et de treize autres légionnaires. La Roumanie entrait ainsi dans la spirale de la violence. Peu après, la désintégration territoriale du pays allait, également, commencer.
Le Pacte Ribbentrop-Molotov, signé à Moscou le 23 août 1939, précisait au 3e point de son Protocole additionnel secret : « Concernant l’Europe du Sud-Est, la partie soviétique réaffirme son intérêt pour la Bessarabie. La partie allemande déclare son total désintérêt pour cette zone. » En quelques lignes, tout était dit. La « partie soviétique » – puis russe, après décembre 1991 – a refusé jusqu’à ce jour de dénoncer ce point ! Fort du « désintérêt » d’Hitler, Staline adressa un ultimatum à la Roumanie, le 26 juin 1940, réclamant la Bessarabie et la Bukovine du Nord. Pressé par le Führer, le roi ne put que se plier à l’injonction soviétique. La Roumanie, qui avait eu l’intention de garder la neutralité en cas de guerre, n’était pas en mesure d’affronter l’Armée rouge ni de défendre, seule, une frontière de 650 km. Quelques semaines plus tard, le 30 août, par ce qui a été appelé le Diktat de Vienne, l’Allemagne imposait à la Roumanie de céder à la Hongrie le Nord de la Transylvanie. Le 7 septembre, le Traité de Craiova, conclu également sous la tutelle d’Hitler, enleva un autre bout de territoire à la Roumanie : le Sud de la Dobroudja était cédé à la Bulgarie. En deux mois, la Roumanie perdait 36 000 km2 et plus de six millions d’habitants. « Le seul parti politique qui a salué ces transferts de territoires et le morcellement de la Roumanie a été le Parti communiste ; après avoir accueilli avec enthousiasme l’ultimatum soviétique, il a envoyé “un salut chaleureux aux peuples de la Bessarabie et de la Bukovine du Nord, affranchis du joug de l’impérialisme roumain”. »
Entre temps, le roi, confronté à une hostilité générale et craignant une révolte des légionnaires, avait demandé, le 4 septembre 1940, au général Ion Antonescu de former un nouveau gouvernement. Le lendemain, Antonescu exigea et obtint des pouvoirs dictatoriaux. La Constitution était suspendue, les prérogatives du roi fortement restreintes. Le 6 septembre, Antonescu forçait Carol II à abdiquer, puis s’octroyait le titre de « chef de l’État roumain et président du Conseil des ministres ». Le roi Michel I succédait à son père sur le trône de la Roumanie.
L’intention initiale d’Antonescu était d’associer au pouvoir les partis historiques. Mais, devant leur refus de participer à une dictature, il fit entrer dans le gouvernement un certain nombre de membres de la Garde de Fer et proclama « l’État national-légionnaire ». Néanmoins, l’entente, fragile dès le début, ne devait pas durer. Le 21 janvier 1941, la Garde de Fer – qui avait même entamé des pourparlers avec les communistes en vue d’une éventuelle association – déclencha une rébellion par laquelle elle cherchait à s’emparer de tous les leviers du pouvoir. En vingt-quatre heures, Antonescu eut raison de cette tentative de putsch, et, le 14 février, l’État national-légionnaire cessait d’exister. Environ 8 000 légionnaires furent emprisonnés, dont la plupart ne recouvrèrent la liberté qu’en 1964. D’autres, rejoignirent tout simplement les communistes.
Il restait à Antonescu de reconquérir la Bessarabie et la Bukovine du Nord, et persuader Hitler d’annuler les effets du Diktat de Vienne. Le 22 juin 1941, la Roumanie entrait en guerre contre l’Union soviétique aux côtés de l’Allemagne. Le 27 juillet, les territoires roumains annexés par l’URSS une année auparavant étaient libérés. Mais Antonescu fit le choix de continuer la guerre, perdant ainsi, en Roumanie, tout soutien populaire et s’attirant l’hostilité de l’ensemble des forces politiques. Une hostilité qui alla en grandissant, au fur et à mesure que s’allongeait la liste des pertes subies par l’armée roumaine. Pourtant, Antonescu avait compris, dès l’automne 1942, que l’Allemagne était en train de perdre la guerre, et s’il s’acharnait à combattre l’Armée rouge, c’est parce qu’il voulait maintenir l’intégrité territoriale de la Roumanie et empêcher le communisme soviétique de s’y implanter. Ce fut un échec sur les deux plans : l’URSS s’empara de la Bessarabie, et rien ne put s’opposer à la communisation du pays.
De leur côté, dès la fin de 1941, les partis historiques avaient pris contact avec les Alliés, afin de négocier un armistice qui allait sortir la Roumanie de la guerre. En 1943, Antonescu commença, lui aussi, des discussions dans le même sens. Le 10 juin 1944, l’opposition accepta, dans leur ensemble, les conditions d’armistice qui lui étaient posées. Antonescu avait perdu du terrain et son sort était scellé. Mais, ce dont nul ne se doutait à ce moment, celui de la Roumanie l’était également.
Soutenu par un Bloc national démocratique dans lequel étaient représentés les partis national paysan, national libéral, social-démocrate, et – à la demande des Britanniques – le Parti communiste, le roi fit arrêter Ion Antonescu, le 23 août 1944. Livré aux communistes, il fut transféré en URSS, puis ramené en Roumanie, en 1946. Il fut immédiatement jugé, condamné à mort et exécuté avec les principaux ministres de son gouvernement.
Le 23 août 1944, à 22 h, par une proclamation au pays, le roi annonçait le changement de régime, la rupture de l’alliance avec l’Allemagne, et donnait l’ordre aux troupes roumaines de cesser les combats contre l’Armée rouge. « Recevez avec confiance les soldats de l’armée soviétique. Les Nations unies ont garanti l’indépendance du pays et la non-ingérence dans nos affaires intérieures. » Telle est la fin du message royal. Quarante-cinq ans de malheurs commençaient à ce moment-là.
Le 6 mars 1945, Andreï I. Vychinski, l’envoyé de Staline, imposait brutalement au roi la formation d’un gouvernement majoritairement communiste, dirigé par Petru Groza. Le 19 novembre 1946, des élections organisées à la demande des Occidentaux étaient largement gagnées par les partis national-paysan et national-libéral, qui obtenaient ensemble, selon le témoignage des observateurs étrangers, 75% des voix. Mais Staline décida de ne pas en tenir compte et d’attribuer la victoire aux communistes. Le 30 juillet 1947, le Conseil des ministres décidait l’interdiction du Parti national-paysan, dernier survivant parmi les formations d’opposition. Au même moment, le nouveau pouvoir opérait les premières arrestations dans les rangs des anciens responsables politiques. Le 30 décembre 1947, le roi Michel Ier était forcé d’abdiquer. La République populaire roumaine était née.
Alliés ou occupants ?
Lorsque, le 23 août 1944, la proclamation du roi fut diffusée sur les ondes de la radio nationale, une vague d’espoir déferla, pour quelques heures, sur le pays : le retour à un régime démocratique et la perspective de la paix semblaient plus tangibles que jamais. Pourtant, c’est précisément à ce moment qu’a commencé la répression communiste en Roumanie. L’arrivée des troupes soviétiques – officiellement alliées, mais d’occupation dans les faits – marqua le début d’une époque qui, en seulement trois ans, allait préparer le terrain pour l’installation de la « dictature du prolétariat ».
Surpris, paraît-il, par l’action du jeune souverain, les Soviétiques, qui avaient déjà prévu l’occupation de la Roumanie par la force, continuèrent la mise en œuvre de leur plan initial, comme si aucun changement n’était intervenu. Les militaires roumains se trouvant sur les lignes du front en Bessarabie ou en Moldavie furent faits prisonniers non seulement après le 23 août, mais aussi après la signature à Moscou de la Convention d’armistice. Plus de 165 000 officiers et soldats roumains, considérés comme fascistes, furent ainsi envoyés dans des camps de travaux forcés au Kazakhstan, en Sibérie, et, plus tard, à Vorkuta, au même moment où, sur le front de l’Ouest, d’autres unités roumaines luttaient aux côtés de l’Armée rouge pour la libération de la Transylvanie du Nord, puis de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et de l’Autriche.
Entre 1944 et 1947, environ un million de militaires soviétiques occupèrent le sol roumain, alors que le régime communiste s’installait à la tête du pays. Dans certaines contrées de la Moldavie on construisit des voies ferrées à écartement élargi, selon les normes soviétiques, afin de faciliter le transport des marchandises – butin et dédommagements de guerre – et des convois de déportés que l’on emmenait aux « travaux de reconstruction » de l’URSS. À ce sujet, il faut signaler le drame des Saxons et des Souabes – minorités d’origine allemande, vivant en Roumanie depuis des siècles – pris dans le collimateur par les Soviétiques dès le 23 août. À la demande de la Commission alliée (soviétique) de contrôle de Roumanie – organisme placé sous la tutelle de Moscou et qui fut l’autorité suprême en Roumanie jusqu’à la signature du Traité de paix – l’État roumain procéda, dans une première phase, au tri des membres de ces minorités d’origine allemande, puis à leur internement dans des camps. Puis, le 16 janvier 1945, la présidence du Conseil des ministres se vit dans l’obligation de déclarer : « Par ordre du Haut commandement soviétique, sont réquisitionnées, afin d’être conduits vers les endroits où un besoin de forces de travail est ressenti, les catégories suivantes de citoyens roumains d’origine ethnique allemande : les hommes de 17 à 45 ans, les femmes de 18 à 30 ans, à l’exception de celles ayant des enfants de moins d’un an. » En vertu de cette mesure, 80 000 personnes furent déportées durant le seul mois de janvier 1945 vers le bassin minier du Donbas et d’autres régions de l’URSS. Plus de 20 % y moururent. Quant aux prisonniers, outre ceux qui furent emportés par les maladies, l’épuisement et la malnutrition, les plus chanceux rentrèrent au bout de sept ans, alors que les autres passèrent jusqu’à douze ans dans les camps soviétiques.
Les années antérieures à la signature du Traité de paix entre la Roumanie et l’URSS se caractérisèrent par la multiplication des abus commis impunément par les troupes soviétiques : pillages, viols, brigandages, attaques à main armée, assassinats en pleine rue, n’épargnaient ni la population civile ni les représentants de l’État. Ainsi, la mémoire collective n’a pu retenir de cette période que l’image d’un « libérateur » se livrant à une forme brutale d’occupation, et lui a associé la formule à la fois amère et ironique « davaï ceas, davaï palton » – « donne la montre, donne le manteau » –, qui rappelle l’injonction utilisée par les soldats soviétiques pour s’approprier les biens des passants. Tous ces méfaits ont été étudiés après 1990, sur la base d’un impressionnant matériel d’archive . Par ailleurs, les services secrets soviétiques prenaient ostensiblement en filature des citoyens roumains, s’immisçaient dans les réunions politiques, effectuaient des arrestations pour leur propre compte. La Commission alliée (soviétique) de contrôle était devenue une sorte de supra-gouvernement qui dictait sa volonté aux autorités roumaines, bien qu’officiellement le pays fut allié et non occupé. Le prétexte sans cesse invoqué était l’application de la Convention d’armistice. Les Soviétiques réprimaient ou interdisaient tout ce qui ne leur convenait pas, tout en expliquant aux représentants américains et britanniques – présents dans la Commission plutôt en tant qu’observateurs – qu’il s’agissait soit d’exigences se rattachant à la mise en œuvre de la Convention, soit de mesures visant à effacer les effets de la dictature et de la guerre. C’est ainsi que, peu à peu, on en arriva, le 6 mars 1945, à installer par la force le gouvernement pro-communiste de Petru Groza, à interdire la presse libre, à instaurer la terreur, à truquer les élections de novembre 1946, à évincer la monarchie, et, en fin de compte, à imposer le parti unique et à institutionnaliser le communisme.
Après la signature du Traité de paix, à Paris, le 10 février 1947, la Commission alliée (soviétique) de contrôle fut supprimée. Néanmoins, les troupes soviétiques, qui auraient dû se retirer par la même occasion, demeurèrent sur le territoire roumain, sous prétexte de maintenir un couloir vers l’Autriche. Ce n’est que onze ans plus tard, en juin 1958, que l’Armée rouge allait quitter la Roumanie à la suite de l’accord passé entre Khrouchtchev et Emil Bodnaras, l’homme de confiance des Soviétiques à Bucarest et haut dignitaire du régime communiste. Mais, pendant tout ce temps, les conseillers soviétiques prirent soin de mettre leur empreinte sur l’ensemble de la vie roumaine – de l’économie planifiée à l’agriculture, et du réalisme socialiste dans la culture à la Securitate.
Cette même période, 1944-1947, fut celle où, sous les apparences du jeu démocratique, étaient posées les bases du futur régime dictatorial. Du 23 août 1944 au 6 mars 1945, trois gouvernements d’authentique coalition se succédèrent à la tête du pays . Dans le premier, les communistes obtenaient le ministère de la Justice, dans le deuxième, formé le 4 novembre 1944, on leur concéda également le ministère de l’Intérieur. Le Parti communiste – qui, à cette date, comptait moins de neuf cents membres – tenait ainsi les principaux leviers qui allaient lui permettre de mettre en œuvre la logique de la violence censée assurer la pérennité du système.
La justice dévoyée
Obnubilés par la doctrine marxiste-léniniste, les communistes se devaient de faire de la lutte de classes la clef de voûte du régime qu’ils s’apprêtaient à imposer. En quelques mois seulement, cela allait se traduire par une répression systématique, impitoyable, témoignant d’une grande habileté dans la gestion de l’horreur. Formés pour la plupart en Union soviétique, les communistes roumains s’ingénièrent à prouver qu’ils ne le cédaiente en rien à leurs maîtres. Le fait d’avoir revendiqué le ministère de la Justice lors de leur entrée dans le gouvernement de coalition mis en place le 23 août 1944, n’était nullement un hasard. Le poste revint à Lucretiu Patrascanu, avocat et communiste de vieille date.
Le ton fut donné dès le 26 septembre 1944, lorsque le quotidien du Parti communiste, Scînteia (L’Étincelle), demanda le châtiment « des criminels de guerre et des profiteurs ». Dans cette catégorie furent inclus principalement les grands acteurs de l’économie roumaine, pour la simple raison qu’en attendant l’adoption des lois de nationalisation, il fallait trouver un moyen rapide de s’approprier leurs biens. Avant le 31 décembre, 2 400 personnes furent ainsi arrêtées. Un mois seulement après sa nomination, le ministre de la Justice commençait l’épuration des éléments non-communistes de l’armée et de l’appareil d’État. Au même moment, il décidait la création des « tribunaux du peuple », composés de deux magistrats et de sept « juges populaires », et dont la mission était d’organiser les premiers procès politiques. Des centaines d’industriels, banquiers, grands entrepreneurs, hommes d’affaires, arbitrairement accusés de trahison et d’avoir participé au « désastre du pays », furent condamnés par ces tribunaux à de lourdes peines de prison , assorties, bien entendu, de la confiscation de tous leurs avoirs. Avec des accents triomphalistes, Scinteia rendait compte de ces jugements expéditifs, tout en assurant que les biens confisqués allaient être distribués au peuple. Ce qui, évidemment, ne devait jamais se produire.
Après l’installation du gouvernement communiste du Premier ministre Petru Groza, Patrascanu prit une série de mesures qui transformèrent radicalement l’ancienne législation pénale, en la politisant à outrance. Parallèlement, la justice fut subordonnée aux objectifs de la lutte de classes. Outre les « tribunaux du peuple », il constitua auprès du ministère de la Justice un corps d’ « accusateurs publics » qui remplissait, dans le cadre de ces juridictions d’exception, les attributions de l’avocat général. Bien entendu, les verdicts rendus par les « tribunaux du peuple » n’étaient pas susceptibles d’appel. Le projet présenté par Patrascanu fut approuvé par le Conseil des ministres le 31 mars 1945. Deux jours auparavant avait été promulgué, toujours sur sa proposition, un Décret-loi sur « la purification [sic] des administrations publiques », visant à écarter tous ceux « qui avaient agi sous quelque forme que ce soit dans le but d’instaurer ou de maintenir les régimes dictatoriaux en Roumanie ». Une définition vague, qui, au gré des besoins de répression des gouvernants, pouvait être appliquée à n’importe qui. Il faut signaler la hâte avec laquelle le régime avait adopté ces mesures destinées à légitimer tous les forfaits à venir.
Lucreţiu Pătrăşcanu fut également responsable de la suppression de l’ancien corps de magistrats et de la subordination des juges et procureurs aux intérêts du Parti communiste. Le 15 septembre 1945, à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle année judiciaire, le ministre de la Justice affirmait : «Certes, l’épuration continuera, mais nous voulons plus qu’une épuration : nous voulons que la magistrature en tant que corps, en tant que collectivité, en tant qu’instrument dans le cadre de l’État, fasse réellement preuve d’une autre mentalité et d’un autre esprit que par le passé. » Une déclaration qui faisait peser sur les magistrats une menace constante. Cela devint évident lors d’un procès à l’issue duquel un commerçant de chaussures de luxe, Nelu Mihailescu, fut condamné à 18 ans de prison pour stockage de marchandises à des fins de spéculation. Il fit appel et obtint l’acquittement, mais, entre temps, ses marchandises, confisquées lors de son arrestation, avaient disparu pour réapparaître dans des magasins appartenant à des proches du Parti communiste. Afin de ne pas mettre en danger ce véritable « réseau de financement » du parti, Lucretiu Patrascanu fit suspendre la décision et ouvrit une enquête contre les juges qui avaient acquitté Mihailescu . L’année suivante, le ministre de la Justice acheva la subordination des magistrats, contraints désormais d’exécuter en premier lieu les ordres du Parti communiste et seulement ensuite, si possible, d’appliquer la loi. Le 20 avril 1946, lors d’une conférence de presse, Lucretiu Patrascanu déclarait : « Que l’inamovibilité des magistrats soit de nature constitutionnelle, c’est une fausse affirmation ! C’est le gouvernement qui décide et tranche cette question ! » En matière d’inamovibilité, c’est donc Patrascanu qui détenait le pouvoir, en sa double qualité de ministre de la Justice et de membre du Comité central du Parti communiste.
Aux côtés des juges siégeaient les « assesseurs populaires » désignés par le parti. Ainsi composée, la cour pouvait intervenir dans tous les procès et présenter ses propres preuves et témoignages. Elle était libre de commettre d’office les avocats de la défense, dont le rôle se limitait, la plupart du temps, à formuler des excuses pour les prétendus délits imputés aux accusés.
Après avoir sérieusement ébranlé la magistrature – épurée entre temps de tous ceux qui avaient désapprouvé les mesures visant à placer la justice sous contrôle politique –, Patrascanu annonça, le 16 octobre 1946, qu’il avait achevé le processus de transfert vers les cours martiales des compétences concernant certaines infractions commises par des civils. Ayant ainsi fait main basse sur l’appareil judiciaire, les occupants soviéto-communistes s’étaient donné les moyens d’agir contre l’opposition démocratique. Le 24 novembre 1947, avec l’adoption du projet de loi sur l’organisation de la justice, le travail d’infiltration et de dévoiement du pouvoir judiciaire était accompli. Auteur du projet, Lucretiu Patrascanu déclarait alors : « Par la présence dans les tribunaux et les cours des représentants élus des masses laborieuses des villes et des villages, qui deviennent des juges dotés d’un droit de vote décisif, la justice devient véritablement populaire. » D’ailleurs, la loi elle-même affirmait explicitement : « Les juges sont tenus de défendre les intérêts des classes laborieuses, protéger la nouvelle démocratie et punir les ennemis du peuple. » L’indépendance de la justice n’était plus qu’un souvenir.
Au printemps de 1948, tous les avocats furent radiés du barreau et ne furent réintégrés que ceux qui recevaient l’aval de commissions dominées par les communistes. Le barreau lui-même disparut, remplacé par des collèges d’avocats, sous la direction de membres du parti. Le nombre d’avocats diminua dramatiquement : à Bucarest, par exemple, il passa de 12 000 à seulement 2 000 . Les cabinets privés d’avocats avaient, bien entendu, été interdits.
Fidèle à son credo, Lucretiu Patrascanu a construit avec habileté un appareil judiciaire qui allait cautionner les crimes politiques du Parti communiste. Mais, après avoir « réformé » la justice, transformée en un implacable outil de la lutte de classes, après avoir élaboré les justifications juridiques de la répression, il tomba lui-même dans le piège qu’il avait tendu. Le 23 février 1948, il perdit toutes ses fonctions dans la hiérarchie du parti. Le 24 février, on lui retira également son portefeuille ministériel. Et le même jour, dans le cadre d’un discours prononcé à l’Athénée roumain, Teohari Georgescu, le ministre de l’Intérieur, stigmatisait Patrascanu, le qualifiant de lâche, de traître et de déloyal, l’accusant même d’avoir protégé les anciens « criminels de guerre » et d’avoir autorisé la fuite à l’étranger de certains « capitalistes ». Le désormais ancien ministre, que l’on n’avait pas invité à faire partie du præsidium, mais qui se trouvait dans la salle pour fêter l’anniversaire de la création du Parti communiste, écouta en silence ces accusations. Quelques semaines plus tard, le 28 avril, il était arrêté. Condamné à mort, le 14 avril 1954, par le Collège militaire du Tribunal suprême, il fut exécuté le 17 avril.
L’activité déployée par Lucreţiu Pătrăşcanu dans le cadre de ses fonctions de ministre de la Justice a-t-elle justifié son arrestation en tant qu’ « ennemi du peuple » ? A-t-il véritablement été un Saint-Just de « la cause », le communiste sans tache et bon patriote, comme le veut le cliché que l’on fabriqua lors de sa réhabilitation, en 1968 ? On peut en douter. Il semblerait plutôt que la « réforme » entreprise par Patrascanu n’ait pas donné entière satisfaction à ses supérieurs de Bucarest et de Moscou. Comme le notait Reuben H. Markham , Patrascanu, « bien que cruel, ne l’était pas assez. Il a rempli des prisons, mais pas assez de prisons […], il a fait exécuter des criminels de guerre, mais pas en assez grand nombre, il a violé tous les droits civils, mais pas assez brutalement. » En fin de compte, il faut croire que, s’il a été évincé, ce n’est pas faute de zèle de sa part, mais plutôt à cause des luttes secrètes pour le pouvoir, dont il sortit vaincu, et parce que sa définition en termes nationaux du communisme l’avait rendu indésirable .
Le 27 février 1948, quatre jours à peine après la disgrâce de Patrascanu, un nouveau Code pénal était promulgué . Profondément altéré par rapport aux anciens textes, il devint la base législative sur laquelle le pouvoir judiciaire, agissant au nom des « intérêts de classe » du nouveau régime de « démocratie populaire », allait se déchaîner contre les opposants politiques. Ce nouveau Code devait, par la suite, être maintes fois modifié en fonction des besoins de l’appareil répressif et, souvent, en violation des principes fondamentaux du droit. Ainsi, même certaines de ses dispositions générales ont été aménagées, afin de préparer les vagues d’arrestations qui allaient toucher les dignitaires de l’ancien régime, les personnalités politiques ayant appartenu aux partis historiques, ou bien les anciens policiers, gendarmes et officiers de renseignement. Les nouvelles prévisions faisaient fi, par exemple, du principe de la non-rétroactivité des lois, donnant ainsi à la police politique – la tristement célèbre Securitate – la possibilité d’augmenter dramatiquement le nombre d’arrestations. Dans la version de 1948 du Code pénal, les dispositions générales stipulaient (art. 1, § 1) : « Nul ne peut être puni pour un acte qui, au moment où il a été commis, n’était pas prévu par la loi, et ne sera pas condamné à d’autres peines ni soumis à d’autres mesures de sûreté. » Mais le Décret 187 du 30 avril 1949 (Titre 2, Chapitre I : Concernant l’application de la loi pénale dans le temps), remplaça ce paragraphe par une déclaration purement idéologique : « La loi pénale a pour but de défendre la République populaire roumaine et son ordre établi contre les actions dangereuses pour la société, en mettant en œuvre des mesures de défense sociale à l’encontre des personnes qui commettent ces actions. » En revanche, dès sa version de 1948, le Code pénal stipulait explicitement l’application rétroactive des lois dans le domaine des mesures de sûreté qui accompagnaient ou remplaçaient certaines peines pénales (internement dans des hôpitaux psychiatriques, assignation à résidence, interdiction d’habiter une certaine localité ou de la quitter, etc.). Le texte précisait que : « Les lois prévoyant des mesures de sûreté s’appliquent également aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. » Complétant ce principe inique, toute une série de décrets, de règlements et d’ordres du ministère des Affaires intérieures (MAI) devint le « cadre légal » dans lequel les institutions chargées de la répression se livrèrent à l’arrestation, à la déportation dans les colonies de travaux forcés, ou à l’assignation à domicile de toutes les personnes que le régime considérait comme indésirables.
Petit à petit, l’idéologie et la politique s’insinuaient dans des textes légaux qui, quoique jamais publiés, donc inconnus de la population, étaient appliqués très strictement. Tel est le cas du Décret 62 de février 1955 qui devenait l’article 193, § 1 du Code pénal. Y était incriminée « l’activité intense contre la classe laborieuse ou contre le mouvement révolutionnaire, menée à partir d’un poste de direction dans l’appareil d’État ou dans le cadre d’un service secret durant le régime des bourgeois et des grands propriétaires terriens », qui était punie d’une peine de prison avec régime sévère à perpétuité, assortie de la confiscation intégrale des biens. Le deuxième paragraphe spécifiait : « Si les faits décrits dans le paragraphe précédent ont été commis dans le cadre d’un poste autre que de direction, la peine sera la prison avec régime sévère de 5 à 25 ans et la confiscation intégrale ou partielle des biens. » En vertu de ces dispositions, jamais publiées dans les éditions successives du Code pénal, « ont été jugés et condamnés, en 1955 et 1956, des milliers d’anciens employés de la police, de la Sûreté et du Service secret, arrêtés de 1948 à 1950 et maintenus pendant tout ce temps en détention sans aucune justification. » Dans certains des cas étudiés , les peines prononcées furent égales au nombre d’années déjà passées en détention, ce qui, dans le contexte politique créé par la Conférence de Genève, pourrait indiquer une tentative de réparation des abus commis. Mais, et ceci est instructif sur la nature du régime communiste, cette tentative d’entrée dans la légalité a été faite, justement, par la transgression de normes juridiques fondamentales. Bien entendu, toutes ces procédures sont demeurées secrètes.
Parallèlement à l’établissement de la rétroactivité des lois, le régime s’appliqua à affirmer clairement le caractère de classe de la législation pénale. L’article 1, § 2, du Code pénal de 1948 instituait des sanctions pour les faits « socialement dangereux », définis au paragraphe suivant comme étant « les faits qui, par leur nature ou par la manière dont ils sont commis, portent atteinte à ou mettent en danger la sûreté de l’État ou l’ordre social ». Le Décret 187 du 30 avril 1949 reformule ce paragraphe, en élargissant le champ de la répression : « Les faits considérés comme dangereux pour la société peuvent être sanctionnés même dans les cas où ils ne sont pas expressément désignés par la loi en tant qu’infractions. » Dans ces cas, l’accusation devait se fonder sur les dispositions légales applicables aux « infractions semblables ». Les organes de poursuite pénale se voyaient ainsi accorder des pouvoirs discrétionnaires, la « technique des analogies » étant notamment utilisée par la Securitate, sous le contrôle des conseillers soviétiques, lors de la fabrication des inculpations. Abrogé par le Décret 102 du 29 février 1956 – à une époque où les autorités de Bucarest cherchaient à accorder leurs actions avec « l’esprit de Genève » – ce paragraphe fut remplacé dans le Code pénal en vigueur le 1er juin 1958 par une plus large définition de l’objet de la loi pénale. Ainsi, l’article 1, qui établissait « la légalité des peines infligées et des mesures de sûreté », reprenait la définition de la loi pénale en tant que protectrice de la République populaire roumaine et de son ordre établi, désignant comme dangereuse pour la société « toute action ou manquement qui porte atteinte à la structure économique, sociale ou politique, ou encore à la sûreté de la République populaire roumaine, ou trouble l’ordre de droit établi par le peuple avec, à sa tête, la classe ouvrière. »
Conçue pour éliminer ou annihiler les représentants de l’ancien régime, cette « justice de classe » était également censée châtier toute action d’opposition au pouvoir communiste. Pendant vingt ans, et à travers toutes les versions du Code pénal, la définition de ces actions, regroupées sous le titre « Crimes et délits à l’encontre de l’État », est restée inchangée. Seule la durée des peines infligées a varié quelque peu. Au cours des années 1948-1952 et 1957-1959, lorsque la répression atteignit son point culminant, les articles compris dans ce chapitre furent très souvent utilisés. Par exemple, les prétendues actions « terroristes », avec ou sans constitution en bande, étaient punies de la peine de mort (article 207). La menace de commettre des actions terroristes contre des militants du parti ou des personnes déployant des « activités d’intérêt civique » était passible de peines allant jusqu’à 25 ans de prison. Mais c’est l’article 209, concernant « le crime de conspiration contre l’ordre social », qui fut le plus fréquemment utilisé. Il prévoyait de lourdes peines de prison, allant, après la modification du Code pénal par le Décret 1 de 1959, jusqu’à 25 ans de prison. Ainsi, la constitution d’organisations « dans le but de changer l’ordre social existant » ou le fait d’agir dans le cadre d’une telle organisation pouvaient être punis de 15 à 25 ans de travaux forcés et de la perte des droits civiques pour une période de 5 à 10 ans. Mais si les faits présentaient « un caractère particulièrement grave », le tribunal pouvait infliger la peine de mort. La propagande, l’agitation hostile ou toute forme d’aide apportée à une organisation « terroriste », ainsi que le dénigrement ou la calomnie en public des institutions de l’État ou des représentants de l’État étaient sanctionnés de peines allant jusqu’à 10 ans de prison, voir plus, lorsque ces actions avaient des conséquences graves.
Par comparaison, l’association en vue de commettre des crimes et délits de droit commun (article 315) n’était punie que d’une peine de prison correctionnelle allant de 2 à 6 ans. Non seulement le régime se montrait plus clément pour les délinquants de droit commun que pour les prévenus politiques, mais il faisait également des distinctions entre diverses catégories de voleurs. Ainsi, lorsque le vol était commis au détriment du bien public, la peine allait jusqu’à 12 ans de prison, assortie de la confiscation intégrale des biens s’il s’agissait d’un vol de céréales « commis soit dans les champs, soit dans n’importe quel autre lieu »(Décret 446 du 21 septembre 1957) . En contrepartie, le vol commis au détriment de la propriété privée était sanctionné d’un maximum de 5 ans de prison correctionnelle.
Les infractions dirigées contre l’ « économie nationale » étaient définies par l’article 209, § 1-3. Toute « action de sape » à l’encontre de celle-ci était punie de la peine capitale, ou de travaux forcés pour une période de 5 à 25 ans. Le même châtiment était réservé à ceux qui se rendaient coupables de destructions ou dommages par « non-accomplissement conscient de certaines tâches ou leur accomplissement avec une négligence volontaire ». Si les conséquences de ces agissements étaient jugées graves, le coupable encourait la peine capitale . Les actes de révolte ou d’instigation à la révolte étaient sanctionnés tout aussi sévèrement en vertu des articles 210-212, ainsi que les actes de rébellion, définis dans les articles 258-262 .
L’année 1958 marqua un durcissement de la législation répressive et un élargissement des moyens d’inculpation mis à la disposition des enquêteurs de la Securitate – ce qui n’est point un hasard : les troupes soviétiques venaient de quitter le territoire roumain, et les dirigeants de Bucarest tenaient à prouver qu’ils maîtrisaient la situation interne, étant donc à la hauteur de la confiance que Moscou leur témoignait. Le Décret 318 de 1958 (articles 184-188 et 190-192) prévoyait la peine de mort pour le crime de trahison de la patrie et collaboration avec l’ennemi en temps de paix ou de guerre, ainsi que pour « l’action dirigée contre un allié luttant en commun avec la Roumanie » (article 189) . Le même décret prévoyait, par la modification de l’article 194 du Code pénal, la peine de mort pour les espions étrangers capturés sur le territoire roumain. La peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité étaient également applicables en cas de divulgation de secrets d’État. Mais la justice se montrait tout aussi sévère lorsqu’il s’agissait de données qui, sans entrer dans la catégorie des secrets d’État, « n’étaient pas destinées à la publication », ou bien en cas de communication de documents et informations de toute sorte « pouvant conduire à l’affaiblissement du régime de démocratie populaire ». Le refus de rentrer en Roumanie d’un fonctionnaire « chargé d’une mission d’État ou d’intérêt civique » à l’étranger, assimilé à la trahison, était puni d’une peine de 25 ans de prison, assortie de la confiscation des biens et la perte de certains droits civiques.
Par ailleurs, la partie spéciale du Code pénal concernant les infractions « contre la sûreté intérieure de l’État » traite de l’usurpation de fonctions, des infractions commises par les fonctionnaires d’État, de l’offense au drapeau, ou du « délit contre la sûreté des États étrangers, contre le droit à la paix et contre les bonnes relations internationales ».
Essentielle dans un tel système, la délation est, elle aussi, réglementée par la loi. Ainsi, l’article 228 précisait que « celui qui, ayant connaissance de l’accomplissement de l’une des infractions définies » par les articles contenus dans la partie spéciale du Code pénal, omet de dénoncer le ou les coupable(s), « commet l’infraction d’omission de dénonciation et est puni d’une peine de prison correctionnelle allant de 1 à 5 ans ». En revanche, dans une véritable invitation à la délation, le même article promettait : « Ne sont pas punies les personnes qui, avant le début de toute poursuite, auront porté l’infraction à la connaissance des autorités compétentes, ou qui, même après la découverte des coupables ou bien après le début des poursuites, ont facilité leur arrestation. » De même, l’article 231 prévoyait l’exemption de peine pour ceux qui dénonçaient aux autorités toute infraction dirigée contre la sûreté intérieure de l’État « avant qu’elle ne fût découverte et en temps utile, de manière que son accomplissement soit empêché » .
La législation pénale – contenue dans le Code pénal, ainsi que dans les lois spéciales ou les décrets qui l’ont modifié et complété pendant les deux premières décennies de régime communiste – a été appuyée par toute une série de mesures législatives destinées à définir avec plus de précision le cadre d’action des organes répressifs, tout en augmentant leur efficacité. Il s’agit de mesures administratives prises par le ministère des Affaires intérieures à l’encontre d’une certaine catégorie de personnes, sur la base de décrets et décisions du Conseil des ministres, et qui, pour la plupart, avaient un caractère secret. Selon la Note d’étude n° 00880015 du 14 décembre 1967, rédigée par le Service « C » du Conseil de la Sécurité de l’État – l’un des noms successifs de la Securitate –, à partir de 1949 furent prises, outre l’emprisonnement, des mesures de déportation et d’assignation à résidence, d’internement dans des colonies et unités de travail et de désignation de lieux obligatoires de travail pour certaines personnes qui, sans qu’elles puissent être inculpées pénalement, faisaient l’objet d’actions répressives réglementées par la Grande Assemblée nationale ou le Conseil des ministres.
La Constitution adoptée en 1952 résumait dans l’article 65 la conception communiste de la justice : elle était censée « défendre le régime de démocratie populaire et les conquêtes des travailleurs, assurer le respect de la légalité populaire, de la propriété publique et des droits des citoyens ». Les bases de la violence étaient posées.
Telles furent, brièvement énumérées, les mesures se voulant à la fois légales et légitimes qui permirent l’installation et le fonctionnement du système répressif des vingt premières années de communisme en Roumanie. À partir de 1967, celles qui transgressaient de manière trop flagrante la Constitution furent abrogées, mais les mesures punitives à l’encontre de l’opposition ont été intégrées dans le nouveau Code pénal, adopté par la Grande Assemblée Nationale le 21 juin 1968. Plus nettement encore : le Titre 1 de la Partie spéciale établissait des peines sévères, et ceci jusqu’en 1989, pour l’opposition au système, la propagande anti-communiste et la non-dénonciation des actes d’opposition.