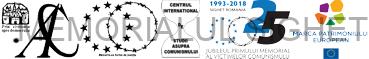Romulus Rusan
Motto
« Prenez garde à que les représentants de l’opposition politique soient enfermés. Que l’on s’occupe particulièrement de ceux d’entre les opposants qui jouissent de l’estime de la population autochtone. Avant qu’ils ne consolident leur position dans la conscience des masses, il faut absolument les liquider par les soi-disant “événements imprévus” ou mis en prison sous l’accusation de crime de droit commun. »
(Extrait de la Directive NKVD du 2 juin 1947)
« Je jure de haïr de tout mon être tous les ennemis de la patrie et du peuple travailleur. »
(Extrait du Serment des agents de la police politique, la Securitate)
La carte du Goulag roumain a été réalisée en juin 1998, pour l’Addenda du Livre noir du communisme (la traduction en roumain étant, par ailleurs, la première sur plus de vingt pays). Nous avons travaillé durant quelques années à réaliser la cartographie du Goulag, aidés par plusieurs détenus politiques, cumulant des données recensées de leur propre expérience. L’Académie Civique avait également besoin d’une carte pour le hall central de l’immense Mémorial des Victimes du Communisme et de la Résistance, que nous avons créé dans une petite ville dans le Nord extrême de la Roumanie*. Sous la carte, se trouve la devise même du Mémorial : « Lorsque la justice n’arrive pas à être une forme de mémoire, seule la mémoire peut devenir une forme de justice. » – allusion au fait que la condamnation des crimes du passé communiste de la Roumanie ne peut se faire par les moyens de la justice, pour le moment, mais seulement par la mémoire. Apparaissent sur cette carte les pénitenciers, les camps de travail, les centres de déportation, les centres de transit, les asiles psychiatriques à caractère politique, ainsi que les fosses communes et certains endroits de lutte des partisans anticommunistes avec la Securitate, où l’on a pu enregistrer des victimes. Nous avons enregistré plus de 230 lieux de détention, la plupart réunis à Bucarest et autour de Bucarest, mais également dans la plaine du Bãrãgan (la « Sibérie roumaine ») et dans le bassin inférieur du Danube (près des embouchures de Brãila, dans le Delta et sur le trajet du Canal Danube – Mer Noire). Il faut ajouter à ceux-ci plus de cent sièges de la Securitate, où avaient lieu les enquêtes – au niveau local, départemental, régional.
En ce qui concerne les pénitenciers, ceux qui étaient de la plus haute sécurité (Botoşani, Galaþi, Sighet, Râmnicu Sãrat) se trouvaient sur la frontière, ou à proximité, avec l’Union Soviétique, parce que les voies ferrées à écartement de type soviétique, servant à l’évacuation des détenus en cas d’urgence, arrivaient jusqu’à ces lieux. Mais d’autres pénitenciers, tout aussi grands et bien gardés, pour les « ennemis du peuple », les « bandits », les « traîtres », selon les appellations attribuées aux détenus politiques par les communistes, existaient aussi à l’intérieur du pays : à Jilava, Aiud, Gherla. Les asiles psychiatriques à caractère politique étaient situés au nord de la Munténie, à Voila et Sapoca, dans l’Olténie, à Poiana Mare, Jebel, près de Timişoara, mais aussi dans la ville Dr. Petru Groza (ªtei) et dans la ville Gheorghe-Gheorghiu Dej (Oneşti). (Il est intéressant de remarquer que ces deux derniers asiles étaient installés dans des localités portant des noms de leaders communistes) On internait dans les asiles les individus qui ne pouvaient être exterminés ou « rééduques » par des moyens physiques. Il s’agissait, en fait, du dernier procédé de punition et d’annihilation de la personnalité de certains détenus politiques exceptionnels, récalcitrants. On pense même que l’on faisait, dans le célèbre « Hôpital numéro 9 » de Bucarest, des expériences « scientifiques » sur ces « sujets ».
Il faut dire, en abordant la chronologie du système concentrationnaire, que, de même qu’en Russie, où le Goulag a été initié dès le 7 novembre 1918 (selon Vladimir Bukovski, qui a institutionnalisé même cette date du calendrier comme « journée internationale du Goulag »), de même, en Roumanie, la répression a commencé, paradoxalement, immédiatement après que le roi Michel eût déclaré l’armistice, le 23 août 1944. En quel sens ? Dans l’intervalle de vingt et un jours jusqu’à la signature de la Convention de Moscou, le 12 septembre, les sovietiques ont déporté en Russie, en Ukraine, en Karaganda et en Sibérie près de 165 000 soldats roumains, qui étaient, à ce moment-là, alliés, mais qui furent mis dans des trains et emmenés non pas sur le front de l’ouest, mais dans les camps soviétiques. Beaucoup d’entre eux ont disparu durant leur détention. Ceux qui ont accepté de signer le pacte avec le régime communiste sont revenus, seulement eux, avec les deux divisions « Tudor Vladimirescu » et « Horia, Cloşca şi Crişan », incorpores pour le moment dans l’Armée rouge. Ainsi donc, la détention de ceux qui ont exprimé leur refus est une détention politique. Les premiers groupements de prisonniers rapatriés sont apparus sept ans plus tard et sont entrés dans le pays par Sighet, parce que, comme nous l’avons signalé plus haut, l’écartement élargi de 1843 mm de la voie ferrée soviétique arrivait jusqu’à cette ville. En automne 1944, afin d’éliminer les coupables du désastre du pays, comme prévu par la Convention de l’Armistice, quelques milliers de personnes furent arrêtées et internées dans les camps de Caracal, Târgu Jiu et Slobozia, étant accusées d’adhésion profasciste. Parmi elles, furent triés les lots de criminels de guerre, jugés par les Tribunaux du Peuple dans les années suivantes. Beaucoup furent cependant arrêtés pour une attitude anticommuniste ou antisoviétique et non pour attitude profasciste. (Mais, dans le vocabulaire staliniste, la notion d’« anticommunisme » était automatiquement associée à celle de « fascisme »). Libérés des camps, ils ont gardé néanmoins les stigmates, étant par la suite arrêtés à plusieurs reprises pour des fautes imaginaires, avec l’étiquette générique d’« ennemis du peuple », « bandits » ou « traîtres ».
En janvier 1945 a lieu la déportation des Allemands de Roumanie ; plus exactement, 75 000 personnes sont expatriées à Donbas, pour participer à la reconstruction de l’économie soviétique. Tous furent sélectionnés seulement en fonction de l’âge et de leur capacité au travail, puisque l’appartenance politique ne comptait presque pas. Certains étaient, en effet, des anciens membres du « groupe ethnique allemand », prohitlérien, mais la plupart étaient des gens simples, sans engagement politique, qui n’avaient que le tort d’être Allemands. Un cinquième périt durant la détention, les autres sont revenus en Roumanie seulement cinq ans après, toujours par Sighet, dans un état extrême d’épuisement et d’inanition.
Selon un rapport des archives de l’Office des Études Stratégiques américain, dès le 7 mars 1945, donc le lendemain de l’instauration du régime communiste et du gouvernement Petru Groza, une commission dirigée par Evgueni Soukhalov présenta devant une délégation de quatre activistes communistes, dirigée par Ana Pauker, un plan de bolchevisation de la Roumanie pour les trois prochaines années, plan attribué à l’ancien secrétaire du Kominterm, Georges Dimitrov. Parmi les dix points du plan, deux sont importants pour notre étude : « la suppression des partis historiques par l’arrestation, l’assassinat et l’enlèvement de leurs membres », ainsi que « la création d’une organisation de police fondée sur une « milice populaire » du type du NKVD ».
Un regard rétrospectif montre que tous les chapitres de cette instruction furent respectés avec rigueur. Il faut noter que, dès 1945, les organismes classiques de l’État – la Police et la Sûreté – furent remplacés, plus précisément doublés, par le Corps des Détectives, dirigé par Alexandre Nicolski. Le Service Spécial d’Informations passa du Ministère de la Guerre à la Présidence du Conseil des Ministres, étant placé sous la direction immédiate d’Emile Bodnãraş, l’un des leaders communistes formés comme agents de Moscou. Bien des interpellations furent exécutées par ces deux organismes bolchevisés, mais même par des membres du FND (le Front National Démocrate était la coalition qui comprenait, autour du Parti Communiste, quelques autres partis et organisations satellites). Parfois, ces arrestations furent faites par les Formations pour la Lutte Patriotique paramilitaires (organisées toujours par le Parti Communiste) ou directement par les organes du NKVD, lorsque les autorités roumaines semblaient être trop indulgentes. La série de ces arrestations aléatoires allait cependant être poursuivie, d’une façon de plus en plus systématique, de la manière suivante : en 1946, à l’approche des fameuses élections truquées, des milliers de personnes furent arrêtées, pour être empêchées de candider ou de voter ; il s’agissait des membres des partis démocratiques de l’opposition anticommuniste, à savoir le Parti National Paysan (Partidul Naþional Þãrãnesc, PNÞ), le Parti National Libéral (Partidul Naþional Liberal, PNL) et le Parti Social Démocrate Indépendant (Partidul Social Democrat Independent, PSDI), celui qui s’était opposé à l’engloutissement du Parti Social Démocrate par les communistes (Staline disait, à un moment donné, qu’un socio-démocrate était plus dangereux qu’un fasciste).
En 1947, des vagues massives d’arrestations cfommencèrent, toujours dans les rangs des partis historiques, dont les membres étaient considérés, ipso facto, « réactionnaires » et « fascistes ». Le 14 juillet, sur le petit aéroport Tãmãdãu au sud-est de Bucarest, quelques membres importants du parti principal d’opposition (National Paysan), qui avaient tenté de se réfugier en Occident, furent arrêtés. Le parti fut interdit par la loi, et toute la direction, Iuliu Maniu en tête, condamnée à la réclusion à perpétuité, pour « haute trahison ». Iuliu Maniu, Ion Mihalache, comme des milliers d’autres membres du parti, allaient mourir en prison. Le même sort fut réservé, dans les années qui ont suivies, aux libéraux et aux socio-démocrates. Par ailleurs, le 15 mai 1948, furent arrêtés quelques milliers de membres des « Fratries de la Croix » (Frãþiile de Cruce), organisation nationaliste de jeunes, se revendiquant de la « Garde de Fer » (Garda de Fier) d’extrême droite dissoute en 1941. Au même moment, commencent les procès économiques, où beaucoup d’hommes d’affaires sont accusés de sabotage. Ensuite, furent fabriqués des procès fantômes de type soviétique, où étaient convoqués des accusés de provenance très différente, dont beaucoup d’entre eux ne se connaissaient même pas : membres des partis démocratiques, francs-maçons, prêtres, étudiants, membres de l’ancienne « Garde de Fer » ou personnes ayant des relations avec des légations occidentales, afin de suggérer, de cette complexité du lot, que les saboteurs, les légionnaires et les espions américains étaient liés par un plan commun de sabordage du régime.
En 1948, furent arrêtés, en une seule nuit, le 27 juillet, 7 000 anciens membres de la police, preparant ainsi ce qui allait se passer le 30 août, à savoir la création des Services Secrets Communistes, appelés Securitate. Les arrestations massives furent précipitées par le fait que Tito s’était servi de l’ancienne police royale serbe dans ses manœuvres de déclaration d’indépendance vis-à-vis de Moscou.
La Securitate fut créée par les conseillers soviétiques Fedicikin et Tiganov, et ses chefs principaux étaient Pantelimon Bondarenko, Alexandre Nicolski, Vladimir Mazuru et Sergueï Nikonov (celui-ci attaché au service des informations extérieures). Tous étaient des agents soviétiques, sélectionnés par les conseillers Fedicikin et Tiganov pour cloner le NKVD dans la Securitate. La série des arrestations a continué pendant l’été 1948 et les mois suivants avec l’emprisonnement d’un grand nombre de prêtres et évêques gréco-catholiques qui s’étaient opposés au démantèlement de l’Église gréco-catholique et son assimilation à l’Église Orthodoxe. Dans le même temps, des vagues massives d’arrestations s’en suivirent parmi les prélats romano-catholiques, accusés d’espionnage en faveur du Vatican (sic !) et des États-Unis (le Nonce Papal à Bucarest était américain !).
En 1949, après l’annihilation par l’arrestation de la plupart des leaders d’opinion adultes, suivit l’annihilation des jeunes, par le soi-disant « procès de rééducation », qui commença dans la prison de Suceava, continua avec acharnement dans la prison de Piteşti et, d’une manière un peu plus relâchée, à celle de Gherla. Près de mille jeunes furent humiliés, forcés à renier leurs convictions, leur famille, leur foi, obligés de se maltraiter et se torturer entre eux, de détruire, pratiquement, leur propre personnalité. Le « phénomène Piteşti », tel qu’il est appelé, de façon si bénigne, fut suivi d’un procès des tortionnaires, soldé par plus de vingt condamnations à mort. Seulement un an après, eut lieu un autre procès, des geôliers et membres de la police politique, qui avaient organisé et exhorté les tortures. Ils furent condamnés à des peines de prison mineures, et libérés peu de temps après. Les réquisitoires des procès tiraient la conclusion que l’on tentait à Piteşti, à la demande du leader légionnaire Horia Sima, réfugié en Occident, et des « impérialistes américains », de compromettre la Securitate. Telle fut l’interprétation officielle. En réalité, les inculpés étaient en effet étudiants légionnaires, avec, à leur tête, Eugen Ţurcanu, mais ils ont agi, pratiquement, sur les encouragements des agents de la police politique et non d’ordres venant de l’extérieur.
Ce fut ensuite l’épopée du Canal, qui commença à la fin de l’année 1949 et fut considérée par les dirigeants communistes, Gheorghe Gheorghiu-Dej et Ana Pauker, un « tombeau de la bourgeoisie roumaine ». Mais, pour faire le tombeau de cette bourgeoisie, il a fallu trouver une formule d’arrestation ayant des apparences de légalité ou, du moins, semi légalité. Alors, une ordonnance du Ministère de l’Intérieur fut émise, par laquelle étaient arrêtés tous ceux qui « mettaient en péril ou tentaient de mettre en péril le régime de démocratie populaire et la construction du socialisme, ou qui dénigraient le pouvoir de l’État et ses organes ». La procédure reproduisait celle du NKVD : la direction du Canal demandait un nombre de personnes pour y travailler, le Ministère de l’Intérieur chargeait de cette tâche la Direction des Enquêtes, laquelle transmettait, à son tour, l’ordre à la Securitate des régions, où l’on établissait des listes avec les « réactionnaires », les « parasites », les « ennemis du peuple », qui allaient être arrêtés. Sans les auditionner et en l’absence même d’un simulacre de procès, une commission formée de sept Généraux et Colonels de la Securitate signait les listes et les condamnait de la sorte à des peines allant de 12 à 72 mois. (Il faut noter ici que ces peines, appelées « réclusions administratives », étaient calculées en mois, alors que les sentences juridiques proprement dites, émises dans les Tribunaux du Peuple ou les Tribunaux Militaires, étaient émises en années.) Il y eut des centaines de milliers de condamnations de cette sorte, extra-juridiques. Rien que sur les chantiers du Canal Danube – Mer Noire, après quelques estimations minimales, il s’avère qu’il y avait à chaque moment environ 40 000 détenus. Il est difficile de dire combien d’entre eux y ont laissé la vie ; nous reviendrons sur cet aspect.
Une opération brutale, destinée à décapiter l’élite politique, eut lieu dans la nuit du 5 au 6 mai 1950, lorsque furent arrêtés simultanément à Bucarest (ou dans les localités où ils se trouvaient) et déportés à Sighet, dans des convois spéciaux, 90 dignitaires du régime appelé « bourgeois et foncier » (roum. : burghezo-moşieresc). Il s’agissait des Ministres de tous les gouvernements de la période 1919-1945, la plupart âgés (70-80 ans et même 91 ans), allant jusqu’à ceux qui avaient été dans le gouvernement procommuniste de Petru Groza, telles que Gheorghe Tfătărescu (accompagné de ses trois frères !), Bejan, Vântu, Roşculeþ, « compagnons de route » des formations bourgeoises qui avaient accepté de collaborer avec les communistes. Dans l’ancienne prison du XIXe siècle, située sur la frontière soviétique même, ce premier lot fut, par la suite, complété par d’autres, au fur et à mesure que la « collecte » des anciens dignitaires avait lieu. Vinrent ensuite des contingents avec quelques dizaines de prêtres et évêques gréco-catholiques, qui avaient été gardés jusqu’à ce moment-là en résidence surveillée dans des monastères orthodoxes, ensuite un contingent de prélats romano-catholiques, et, en août 1951, le lot des membres du Parti National Paysan, qui, après le procès de 1947, avaient été incarcérés à Galafţi. (Il est intéressant de remarquer que Iuliu Maniu, Ion Mihalache et les autres furent deplacés de Galaţi à Sighet, donc d’une frontière soviétique à l’autre frontière, située aux antipodes.) Ainsi, le nombre des détenus de la prison de Sighet arriva à 180. D’après les données en notre possession, 53 d’entre eux y ont péri. Ils furent enterrés dans des fosses, inconnues encore à ce jour. On suppose qu’il s’agit du « Cimetière des Pauvres », mêlés aux gens sans famille ou à ceux qui mouraient à l’asile psychiatrique ou à l’hôpital de maladies chroniques. Entre temps, périrent trois évêques, quelques dizaines de Ministres et Secrétaires d’État, les octogénaires Iuliu Maniu et Dinu Brătianu (Présidents du Parti National Paysan et du Parti National Libéral). Gheorghe Brătianu, grand historien (Dinu Brătianu l’avait même désigné comme successeur à la direction du parti) est décédé à l’âge de 55 ans. Ceux qui ne périrent pas, furent déportés à Râmnicu Sărat, une autre prison ayant une liaison par voie ferrée à écartement adéquat vers l’URSS. C’est ici qu’est mort, après dix autres années de détention, Ion Mihalache, devenu octogénaire, dans un stade ultime de dégradation de santé. C’est encore ici qu’a souffert, dans un état de paralysie chronique, l’éminent diplomate Rădulescu-Pogoneanu, l’un des artisans de l’acte du 23 août 1944 (il paya son courage par 17 ans de détention. Emmené au dernier moment à l’hôpital-prison Văcăreşti, il y mourut en détention.) Constantin Bebe Brătianu, le secrétaire général du Parti Libéral, fut libéré peu de temps avant sa mort, qui survint dans un hôpital de Bucarest. Ce fut aussi le cas de Constantin Titel Petrescu, le leader du Parti Social Démocrate Indépendant, qui avait attrapé en prison une maladie incurable ; il mourut peu de temps après sa libération. Mais des personnes bien plus jeunes y périrent, comme ce fut le cas (pour ne prendre qu’un seul exemple) du poète Constant Tonegaru, arrêté et accusé d’espionnage parce qu’il distribuait aux familles pauvres les colis qu’il recevait, par l’intermédiaire de l’Église Catholique, de Belgique ; il mourut après seulement quelques semaines de « liberté », à l’âge de 33 ans.
Dans le même temps, commencèrent les dislocations ou évacuations : les familles des personnes arrêtées, ceux qui ne bénéficiaient pas de la confiance des autorités étaient mutés dans d’autres habitations, impropres, de sorte que l’ancienne maison devenait disponible pour les potentats du coin, et l’atmosphère générale était toujours plus effroyable. Dans la nuit du 2 au 3 mars 1949 (la veille du congrès plénier qui décida la collectivisation de l’agriculture), deux mille familles de grands propriétaires furent délogées de leurs habitations à la campagne, déportées dans d’autres localités et assignées à résidence. Une autre déportation, bien plus ample, eut lieu le 18 juin 1951, dans la nuit de la Pentecôte, lorsque 44 000 habitants de la zone limitrophe avec la Yougoslavie (le Banat et Mehedinţi), sur une étendue de 25 kilomètres, furent exilés dans la plaine du Bărăgan. C’était une région peu peuplée, avec un climat difficile, appelée ultérieurement la « Sibérie roumaine ». Chargés dans des trains avec juste de quoi survivre, accompagnés par des enfants en bas âge – parfois même d’un an –, des vieillards, ils arrivèrent dans le Bărăgan où ils furent abandonnés dans les champs et durent construire des masures et survivre sans emplois, en cultivant seuls leurs aliments nécessaires. Ces 44 000 personnes restèrent dans le Bărăgan jusqu’en 1955-1956, et, en rentrant ensuite chez eux, ils trouvèrent leurs maisons et leurs propriétés confisquées.
Revenons aux vagues d’arrestations et de procès : après la révolution hongroise de 1956, 300 étudiants furent arrêtés rien qu’à Timişoara, incarcérés dans une ancienne caserne, à Becicherecu Mic. On leur fit des procès sommaires et certains d’entre eux furent condamnés à des peines de prison allant jusqu’à 8 ans de détention. D’autres étudiants hongrois furent aussi arrêtés à Cluj et accusés d’irrédentisme et de nationalisme. Des étudiants en médecine et en lettres furent arrêtés à Bucarest et condamnés pour avoir eu l’intention d’organiser un meeting sur la Place de l’Université. Cette répression a augmenté de manière considérable après le retrait des troupes soviétiques, en juin 1958, retrait suggéré par Emile Bodnăraş à Khrouchtchev. (En tout état de cause, les troupes étaient stationnées de manière illégale, comme dans tous les autres pays du bloc soviétique ; elles aurait dû se retirer après le 10 février 1947, lorsque fut signé le Traité de Paix ; les soviétiques continuèrent à les maintenir en prétextant la nécessité d’un couloir vers la zone soviétique d’Autriche ; en 1955, les soviétiques quittèrent l’Autriche, mais continuèrent de rester en Roumanie et en Hongrie). En 1958, d’une manière tout à fait inattendue, l’Armée Rouge se retira. C’est alors que les communistes roumains ont cru qu’il était de leur devoir d’être « plus orthodoxes que le Kremlin » en ce qui concernait la mise en pratique des dogmes stalinistes et léninistes, et ils renforcèrent la terreur, de sorte que, dans la période de 1958 à 1961, furent arrêtés des contingents massifs d’intellectuels, étudiants, prêtres, universitaires, le prétexte étant, selon le cas, l’« attitude hostile », les « discussions hostiles », le « complot », le « mysticisme ». En 1958, sous la signature de Ion Gheorghe Maurer, un communiste considéré comme étant néanmoins plus libéral, Président du Présidium de la Grande Assemblée Nationale, fut réactualisée, mot à mot, la décision de 1950, prise à l’époque par la Securitate et maintenant « légalisée » par décret, selon laquelle « ceux qui mettent en péril le régime socialiste ou qui le dénigre » peuvent être arrêtés sans mandat ou procès. Au même moment, eurent lieu les humiliants procès publics dans lesquels furent traînés devant des assemblées d’ouvriers – en fait, des membres de la Securitate – des intellectuels considérés auparavant comme soumis mais qui avaient, entre temps, donné quelques signes d’indépendance. Ce fut le cas du compositeur Mihai Andricu, de l’artiste Militza Pătraşcu, de l’écrivain Jacques Costin. Ces procès avaient lieu à Bucarest, et leurs enregistrements audio étaient diffusés dans les principales villes du pays devant des salles d’intellectuels. Bien que les « assemblées d’ouvriers » demandaient ou vociféraient la condamnation à mort des inculpés, ils étaient finalement libérés, sans pour autant que cette décision soit rendue publique. Bref, le but de ce genre de spectacle était d’intimider les intellectuels.
Il faut dire ici que tout au long des 45 ans de communisme, il y eut aussi trois périodes significatives de grâces et d’amnisties, imposées de l’extérieur, mais suivant les intérêts de lutte au sein du parti. La première eut lieu en 1955, après la Convention de Genève, lorsque Eisenhower et Khrouchtchev se mirent d’accord sur une libéralisation inclusivement du Goulag, en URSS et dans les pays satellites. C’est le moment où furent fermées quelques prisons politiques et une partie des détenus libérés, étant à nouveau arrêtés, sous divers prétextes, par la suite, après la révolution hongroise, entre 1956 et 1960.
Une deuxième période fut celle de 1964. Cette relaxe, générale cette fois-ci, qui eut lieu entre février et août 1964, avait aussi une motivation externe : le Parti Travailleur Roumain (Communiste) clamait son indépendance vis-à-vis de Moscou, amorçant des relations commerciales avec les pays occidentaux. À la mi-août 1964, le drapeau blanc fut dressé sur toutes les prisons et les camps de travaux forcés, ce qui ne signifie pas pour autant que la politique de terreur et d’intimidation n’a pas été poursuivie après la mort de Gheorghiu-Dej, avec l’arrivée de Ceauşescu au pouvoir. Cette continuité s’est soldée par des centaines d’arrestations, mais non des centaines de milliers, comme auparavant, durant la période de Gheorghiu-Dej. Dans un seul registre de sorties des années 80, on peut trouver, dans la prison de Aiud, 331 détenus politiques. Mais il ne s’agit que d’un seul registre et, malheureusement, l’accès aux archives est aujourd’hui presque impossible, les « découvertes » sont aléatoires et on ne peut, surtout pour la dernière période, établir le nombre exact des détenus politiques.
En tous les cas, bien que les relations extérieures étaient déjà totalement dégradées, en 1988 fut appliquée une troisième amnistie importante, qui permit même aux détenus politiques d’émigrer en Occident à leur sortie de prison. C’était une des modalités du régime de préserver sa « tranquillité ».
En revanche, Ceauşescu, nous le savons bien, imagina, en guise de terreur, une méthode bien plus sournoise, par la politique d’endoctrinement et de manipulation à l’échelle de toute la population, par le changement dans la composition sociale – le déplacement des paysans dans les villes et leur enfermement dans les cités-dortoirs des banlieues – et, de manière générale, par l’ingénierie socio-éducative qui aboutit à la création de l’« homme nouveau » et à la dégringolade qui définit et continue de définir la population.
Nous allons nous limiter maintenant à décrire quelques-unes des raisons des arrestations qui étaient contenues dans le Code Pénal, lequel subit à plusieurs reprises des changements. Les articles à caractère politique les plus souvent invoqués étaient les articles 207 et 209, à savoir le « rassemblement en bande », en « groupe » et le « complot contre l’ordre social ». Il y avait, dans le même temps, quelques articles secrets. Par exemple, en 1955, après la Convention de Genève et en vue de l’entrée de la Roumanie dans l’ONU, les communistes essayèrent de mettre un peu d’ordre dans l’évidence du Goulag et – parce que beaucoup de personnes étaient arrêtées sans procès et se trouvaient encore en détention depuis 1948, 1950, 1952 – ils furent obligés d’ajouter au Code Pénal en vigueur quelques articles secrets, qui avaient, contre tout principe de Droit, pouvoir rétroactive. L’article 193/1 fut introduit par décret dans le Code Pénal ; il s’agissait en fait d’un paragraphe additionnel stipulant que les personnes « ayant servi le régime bourgeois et foncier » – à savoir les préfets, les fonctionnaires de l’administration, de la magistrature, de la police etc. – soient condamnées pour « crime contre la classe ouvrière » (puni de 2 à 8 ans de prison), respectivement « crime intense contre la classe ouvrière » (sic !) (peine jusqu’à 25 ans de prison). Bien évidemment, ces condamnations rétroactives à des peines déjà exécutées ne rendaient pas plus légale la justice communiste.
Toujours est-il que, avant d’être lues dans la salle de jugement, les peines étaient établies par les enquêteurs de la Securitate ou, dans bien des cas, par le « Parti ». Un seul exemple : en 1950, pour couper tout lien avec l’Occident, eurent lieu les célèbres procès de la Nonciature, des fonctionnaires des ambassades américaine et anglaise, de la bibliothèque française (300 étudiants furent arrêtés à la sortie de la bibliothèque, condamnés et internés dans des camps de travaux forcés). L’absurde n’a pas de limites quand on apprend, par exemple, que la sentence de ce dernier cas fut prononcée non pas dans la salle de jugement, mais pendant une séance du Bureau Politique du Parti Communiste, sur la proposition d’Ana Pauker, une personne n’ayant aucun lien avec la justice, mais se disant intellectuel du parti. Tous ces prélats, fonctionnaires diplomatiques ou étudiants furent condamnés pour « trahison », respectivement « complot contre l’ordre social ». Certains d’entre eux – par une simple décision administrative.
D’autres chefs d’inculpation qui revenaient assez fréquemment étaient la « trahison », l’« espionnage », le « sabotage », la « diversion », l’« attitude hostile », l’« instigation publique », la « mise en circulation de publications interdites », la « complicité avec le coupable » (l’article 231 stipulait l’obligation des membres d’une soi-disant « bande » de dénoncer ses collègues). Ceux qui « savaient quelque chose » et ne dénonçaient pas le coupable étaient également condamnés pour « omission de dénonciation » (même lorsqu’il s’agissait d’une mère ou d’un frère). Il y avait aussi le « passage frauduleux de la frontière » : il serait intéressant de voir combien de milliers de personnes furent arrêtées pour avoir voulu quitter la Roumanie, combien furent condamnées et combien furent même tuées sur la frontière ou sur l’autre rive du Danube, en Yougoslavie. Toujours là, dans le domaine des crimes indirects, des crimes sociaux, on peut inclure environ 10 000 femmes décédées suite à des avortements illégaux, dans leur tentative d’échapper aux lois draconiennes de la natalité imposées par Ceauşescu.
Mais le chapitre le plus mystérieux de nos recherches reste cependant celui concernant les morts du Goulag roumain. On ne saura probablement jamais combien de détenus politiques y sont morts, car le massacre était tellement grand, que, dans bien des cas, on ne produisait plus de documents et les documents existants ont vraisemblablement été détruits. Si une étude basée sur des données officielles de la Securitate n’a pas été possible, certains détails peuvent néanmoins être trouvés dans les registres du parti, car les communistes ont eu la faiblesse de se démasquer les uns les autres. Lorsqu’ils voulaient se débarrasser de l’un de leurs rivaux politiques, ils lançaient une enquête ; c’est ce qui arriva en 1953 avec l’ancien Ministre de l’Intérieur Teohari Georgescu, qui avait été écarté en 1952, suite aux « thèses de juin » incriminant l’étrange « déviation de gauche-droite » (sic !). La seconde dénonciation eut lieu en 1967-1968, lorsque Ceauşescu, pour se débarrasser de son puissant rival, Alexandre Drăghici, Ministre de l’Intérieur des années 50, déclencha une enquête similaire à son encontre, mais où seuls les crimes contre les communistes eux-mêmes furent invoqués. Il s’agissait, en l’occurrence, du procès Pătrăşcanu, des procès des illégalistes, donc pas de la totalité du Goulag roumain. Il y a peu de chances, donc, d’arriver à établir ou ne serait-ce qu’à estimer le nombre de morts des prisons. Dans la recherche que j’ai entreprise au Centre International d’Études sur le Communisme dans le cadre du Mémorial de Sighet, nous avons identifié à ce jour 8 000 noms à partir de deux sources. Malheureusement, seulement une petite part de ces source est officielle. Les autorités roumaines préfèrent une indifférence cynique, souhaitent la réconciliation mais en l’absence de toute connaissance du passé. Ce passé est purement et simplement occulté, de sorte que non seulement les jeunes d’aujourd’hui mais même les personnes de 40 – 50 ans ne savent plus ce qui s’est passé en Roumanie des années 1945-1989.
Mais combien furent-ils pourtant ? À travers les actes écrits et les sentences des tribunaux militaires, nous avons pu identifier 550 000 condamnés politiques par procès, mais le nombre des détenus administratifs est au moins egal. En y ajoutant les prisonniers illégalement arrêtés par les Soviétique après le 23 août 1944, les déportés des différentes périodes, les expulsés, les assignés à résidence, les victimes du frontiérisme, près de 80 000 paysans enfermés pour avoir refusé la collectivisation (chiffre minimale, reconnu même par le Parti dès 1952), les femmes décédées suite à des avortements improvisés – le nombre de tous ces gens privés de liberté pendant les 45 ans de communisme peut aller jusqu’à deux millions.
Ces dix dernières années, nous avons pu réunir au Centre d’Études sur le Communisme, près de 93 000 « fiches matricules pénales », fiches d’incarcération, appartenant à plus de 71 000 anciens détenus politiques : la différence vient du fait que certains détenus, en passant par plusieurs prisons, détiennent plusieurs fiches. En partant de ces archives, nous avons entrepris un « Recensement de la population concentrationnaire de la Roumanie des années 1945-1989 ». L’échantillon de travail représentant, selon nos estimations, presque 5% de la totalité, et les documents de travail étant officiels, il nous est permis de penser que notre étude statistique, qui sera achevée et publiée prochainement, aura une objectivité scientifique incontestable en ce qui concerne les proportions intérieures du Goulag roumain. Je puis seulement dire, à partir du calcul préliminaire rendu public en novembre 2005, que même si le nombre d’intellectuels, fonctionnaires, politiciens ou personnes exerçant des profession libérales était proportionnellement supérieur, les représentants de la classe ouvrière sont plus nombreux. 28,8% de la totalité des condamnés sont des paysans et 13,5% des ouvriers. Même si ces deux chiffres reflètent, d’une certaine façon, les proportions démo-sociales des années 50, lorsque l’on enregistre l’un des pics du Goulag, le grand nombre d’ouvriers et de paysans arrêtés durant la période de l’instauration du communisme nous permet de formuler au moins deux conclusions : 1) d’abord, la politique du parti communiste d’« alliance avec la classe ouvrière et la paysannerie travailleuse » n’était rien de plus qu’un slogan mensonger ; et 2) ensuite, le peuple roumain n’a jamais reçu le communisme les bras ouverts, comme l’affirment, de plus en plus souvent, certains chercheurs nostalgiques ou « politiquement correct », profitant du fait que les autorités roumaines refusent encore d’ouvrir les archives pour pouvoir faire des recherches scientifiques en toute liberté.