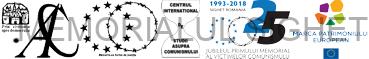Je continue à examiner ce qui fait que la Roumanie est un espace privilégié de mémoire.
J’avais écrit il y a quelques années, en 2001 je crois, un petit texte pour une rencontre du Pen Club roumain. Ce texte était influencé par ma visite récente du Mémorial de Sighet. Ce mémorial est établi dans une ancienne prison. Il résulte du travail de Ana Blandiana, une poétesse roumaine, dissidente sous l’ancien pouvoir communiste et de son mari Romulus Rusan. Des gens que j’aime et admire.
«Dans la rue, deux petits garçons de cinq ou six ans jouent avec des pistolets en plastique. Il fait très chaud, orageux. C’est le début de l’après-midi. Il y a là une odeur de Far-West. Et pourtant, celui qui vient comme moi de la proximité de l’océan et d’un pays privilégié, devrait plutôt parler de Far-East. Les enfants jouent à tirer sur les rares voitures qui passent en soulevant la poussière de cette rue pavillonnaire. Alignement un peu hétéroclite de demeures encastrées dans une banlieue qui ne fait que jouer à la banlieue tant on est proche du centre ville.
A quelques dizaines de mètres, un bâtiment imposant, fermé comme un coffre-fort peint en jaune donne l’impression d’enclore l’espace et de détenir un secret, sinon un trésor.
Ces enfants qui jouent à la guerre et qui miment la violence en accompagnant leur tir de bruits saccadés, ressemblent à tous les enfants qui regardent la télévision et dont les mythes fondateurs sont devenus ceux de la «frontière» américaine et de ses avatars contemporains.
Mais en même temps, ils ressemblent à tous ceux qui les ont précédés dans cette ville depuis des siècles, depuis son essor commercial qui en fait une grosse bourgade dans un environnement de prairies et de pâturages. Ils ont les mêmes jeux que tous ceux qui, à leur âge ont traversé cette rue à cheval, en carriole ou pour accompagner des troupeaux. Mais ils ne savent pas – le savent-ils au moins par intuition ? – qu’ils voisinent avec un espace réel de la pire violence et de la mort ? Un des espaces les plus sinistres imaginés par le pouvoir qui a structuré mentalement et physiquement la jeunesse de leurs parents, comme la vie entière de leurs grands-parents. Comme si cette vie qu’ils ignorent encore et dont ils seront aussi dépositaires, un jour, avait pendant de trop longues années, été faite seulement d’interdictions, de drames et de secrets.
La prison de Sighet, devenue mémorial, restera certainement, grâce à Ana Blandiana qui a souhaité y inscrire un espace symbolique, le lieu de la lecture d’une fracture de l’un de ces coffres-forts qui transforment une nation en un réseau de bastions sous contrôle.
Nous avons vécu par procuration en décembre 1989 l’ouverture du mur et la déchirure d’un rideau opaque qui avait obscurci notre vision pendant cinquante années, au point de nous rendre aveugle aux quelques témoignages que nous pouvions lire ; et sourds aux plaintes qui nous parvenaient. Ouverture dont nous avons tous parlé comme dans un soulagement expiatoire. Dans l’émotion du moment. Images télévisées, cinématographiques, retransmises dans l’espace mondial des images. Et puis, plus rien…
Comme s’il s’agissait d’un geste inaugural et suffisant. Suffisant parce que si un processus était lancé, dans notre esprit rien ne devait pouvoir l’arrêter.
Est-on vraiment si aveugle sur l’autosuffisance de la démocratie quand on prend la réalité du respect de l’autre comme un acquis ?
De la première déchirure des rideaux, au percement du «Mur», des coups de haches donnés dans les portes de prisons, dans les barbelés des camps, mais aussi dans les armoires des archives, le chemin est pourtant très long. Nous devons assumer collectivement ces effractions nécessaires. Nous devons tous ensemble ouvrir, encore ouvrir, lire et transmettre.
Il faudrait que l’on puisse faire comprendre – et pour faire comprendre que l’on puisse faire toucher du doigt – ce que signifient vraiment ces lieux de l’enfermement. Ils ont à la fois symbolisé tout ce qui est permis, sans freins aucun, lorsque l’on se place à l’abri des regards. Et ils ont tout autant donné cours à la puissance de ceux qui ont su faire de ce «secret magnifique» un argument de la terreur.
Qu’est-ce que cette prison de Sighet ? On pourrait dire d’abord : un si petit système. Il ne s’agit tout compte fait de trois étages de cellules, des dépendances, des salles de gardes, de tout ce qui fait l’économie d’une société retirée du monde – une sorte de «monastère de l’horreur».
Mais lorsqu’on le regarde vraiment de très près, il apparaît comme un système «exemplaire». Il démontre que le travail d’élimination qui a été entrepris ici n’est qu’une illustration d’un système plus vaste. Nœud d’un réseau de lieux qui partagent des fonctions complémentaires.
Pour revenir à l’idée de coffre-fort, ce système s’apparente beaucoup, tout respect dus à ceux qui en ont vécu la souffrance dans leur chair, à ce que l’on connaît aujourd’hui dans le monde de la finance et dans ce que l’on pense connaître du monde de l’information globalisée. Les décisions étaient centralisées dans ce cube géant – autre coffre-fort métaphorique – qui est tombé comme un objet étranger dans le corps millénaire de la ville de Bucarest.
Je ne sais pas pourquoi en effet, le Palais du Peuple m’est apparu la première fois que je l’ai vu assez semblable au vaisseau spatial des «envahisseurs» qui couvre une ville d’un regard glauque s’infiltrant partout. Mais pourtant, ces décisions centralisées peuvent être également relayées, amplifiées, diffusées par des relais qui dupliquent exactement «l’ordre nécessaire», pour répondre au mieux à l’urgence locale de réprimer la contestation. Fonctionnelles et fonctionnarisées. L’ordre totalitaire génère tout naturellement des fonctionnaires de l’horreur, eux-mêmes décentralisés et détachés de l’objet qu’ils traitent. Le pouvoir est alors partout, comme aujourd’hui l’information est partout. Même virtuellement. Simplement parce que l’ordre est immédiatement disponible à la porte des guichets de la répression, comme l’information est disponible dans les distributeurs télévisuels ou informatiques. Il se thésaurise, il se nourrit de sa propre substance. Il se répand comme un immense flot invisible, comme l’air que l’on respire.
La mutualisation de la peur, c’est aussi la globalisation de la peur. Chacun est comptable d’une partie du système. Tour à tour en effet, comptable de la peur et de l’espoir. Tour à tour, agent de transmission de ce qui a été décidé et amplificateur de ce qui ne l’est pas encore. Par force ou par lassitude. Le rythme de ces va et vient des heures est directement réglé par les lieux du secret, comme si y battait le pouls permanent d’un mouvement inéluctable.»
Je voulais simplement dire à la fin de mon intervention, qui devait porter sur la globalisation de la littérature, que la globalisation libérale tant espérée par ceux à qui on avait retiré la part la plus importante de leur liberté – communiquer – présente probablement, même si elle fonde un «village global», autant de dangers que la globalisation totalitaire qui a isolé une part du monde pendant des dizaines d’années.
J’ai tenté de traduire à la fois mon réalisme un peu désespéré devant les globalisations passées des modèles totalitaires et les globalisations actuelles des modèles dits libéraux, mais aussi mon espoir indéracinable devant tout ce qui fait que ces individus en moins que nous sommes dans nos identités singulières, peuvent devenir des individus en plus pour ceux dont l’identité cherche à s’enrichir.
J’avais été aussi impressionné cette année là par la lecture d’un texte court écrit par l’écrivain espagnol Juan Goytisolo en 1985 à l’occasion de la remise du prix Europalia qui lui avait été décerné.
Après avoir remarqué combien son identité européenne était paradoxale, tant il se sent imprégné d’Afrique, il évoque lui aussi la question de l’universel. Je cite : «Les sentiments de sympathie et d’immédiateté qui me poussèrent à découvrir les régions du sud de l’Espagne qualifiées avec mépris d’africaines, pour m’intéresser ensuite au monde arabe dans sa diversité ont été le fait d’un Espagnol «ranimé» par son long séjour de l’autre côté des Pyrénées : d’un Espagnol qui, sans cesser de l’être, avait contracté la curiosité européenne.»
Et de conclure sur une notion qui me semble posséder une utilité dans la recherche de l’Europe que je mène, contre les excès ou les menaces de la globalité. «L’Europe à laquelle j’appartiens et dont je me sens l’héritier n’a pas oublié les paroles du poète : conscient de la généralisation de ses techniques, de sa civilisation, de ses modèles de comportements, tout Européen attentif à la palpitation de l’universel sait qu’un non-Européen intégré à l’Europe, de gré ou de force, devient lui-même européen, mais, comme l’a très justement observé le Marocain Abdallah Laaroui, avec quelque chose en plus, dans la mesure où il possède une dimension culturelle autre. L’Européen en moins va alors compenser son inévitable carence par l’intérêt indigné et la solidarité qu’il manifeste à l’égard des drames qui ravagent le monde par-delà les frontières de son continent étriqué… C’est à cette Europe de l’œcuménisme et de la modernité que j’adhère, en espérant que le nombre modeste mais significatif des en moins voudra bien accueillir en ma personne un Européen en plus.»
Une expérience de modestie.
Michel Thomas–Penette
articol aparut in “Le Monde” in data de 25 octombrie 2006